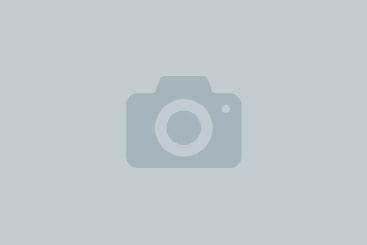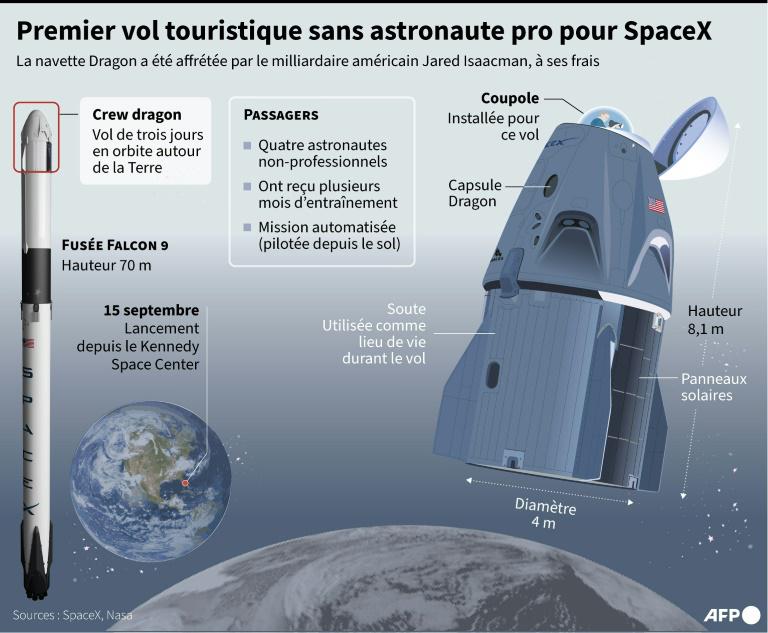Dujardin raconte tout sur The Artist et le prochain OSS 117
LE FIGARO. - Au Festival de Cannes, The Artist devait être présenté hors compétition. Finalement, vous êtes entrés dans l'arène. Pourquoi?
Jean DUJARDIN.- Je pense qu'on a tous voulu au départ, secrètement, être en compétition. Si nous allons à Cannes, c'est pour participer. Sinon, nous n'y allons pas du tout.
Michel HAZANAVICIUS.- L'envie était assez assumée. Nous avons beaucoup travaillé pour être prêts à temps. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, souhaitait voir le film. Il restait une place en compétition. C'était soit The Artist, soit Les Biens-aimés. Moi j'étais vraiment pour jouer la compétition. Je me souviens avoir cité une phrase de Maradona: «Rentrer dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer, c'est comme danser avec sa sœur».
Est-ce que le Prix d'interprétation masculine a changé quelque chose pour vous?
J.D. - Cela fait très plaisir. Ça a été une journée un peu hors norme. Je n'arrive toujours pas à savoir si cette récompense correspond à une fin d'étape ou si c'est un passeport vers une autre. Quand on me l'a annoncé dans l'après-midi, j'ai d'abord été très étonné. Puis j'ai éprouvé une petite joie, qui s'est transformée en grande trouille. Ce n'est pas mon métier de recevoir un prix. Ma façon d'accepter les honneurs peut paraître légère et distanciée. Mais c'est pour moi une sorte de garde-fou. Je me protège. Cela me permet de repartir de zéro à chaque nouveau film, d'être disponible pour autre chose. Je n'ai que 39 ans, bon sang! J'ai encore plein de choses à faire
M.H. - De toutes façons, rien n'est jamais acquis. Il ne s'agit pas comme dans un escalier de rejoindre le troisième étage. Qui sait? Dans son prochain film, Jean peut redescendre au premier ou passer directement au sixième.
J.D. - J'ai bien conscience que c'est à moi de donner le rythme. Mais, forcément, les choses m'échappent. Mon image m'échappe. J'essaie de contrôler ces moments là. Le prix d'interprétation à Cannes, c'est formidable. Mais, j'y suis allé avec une grande peur mêlée d'un grand plaisir aussi. Il y a eu trop de belles choses: Robert De Niro qui me dit: «C'est toi!». La salle qui est debout. Je me suis dit: «Bon, on te veut du bien, donc sois heureux et accepte-le». L'euphorie s'est arrêtée je pense vers 3 heures du matin quand je me suis couché, avec ma femme Alexandra.
The Artist pourrait concourir aux Oscars à Hollywood dans la catégorie «Meilleur film». Comment en êtes-vous arrivé là?
M. H.-Nous n'y sommes pas encore. Sans doute, notre film est positif et divertissant. C'estune bouffée d'air frais dans les festivals où la plupart des films n'ont pas pour ambition la joie de vivre. Cela lui donne un ticket d'entrée inestimable. Il a été imaginé dans le même esprit que les films hollywoodiens des années 1920 - 1930, pour s'échapper du quotidien. Ce qui n'est pas le cas de tous les films aujourd'hui
Les frères Weinstein, qui ont produit financé Pulp Fiction et Le Discours d'un roi, distribuent The Artist aux États-Unis. Ils font faire campagne pour le film aux Oscars. Pensez-vous qu'ils peuvent réussir?
M.H. - La tradition veut que les films qui racontent Hollywood plaisent à Hollywood. Harvey Weinstein va peut-être jouer sur cette corde nombriliste. Mais, je le répète, nous n'y sommes pas encore. En revanche, si on nous le demande, nous serions fous de dire non.
Bérénice Béjo. (Warner Bros)
Quels souvenirs gardez-vous du tournage dans les mythiques studios de la Warner?
J. D. - C'est à la fois un souvenir d'acteur et de touriste. Je découvrais tout. Je mangeais très vite pour rejoindre le plateau et le voir vide, toucher les murs. Je suis rarement dans ma loge pour des films. Là j'y étais encore moins. C'était très motivant pour l'imaginaire d'être ici. Même quand on ne tournait plus, ça continuait. On vivait dans une villa sur les hauteurs d'Hollywood. L'intérieur de la maison ressemblait à la demeure du film Sunset Boulevard (Boulevard du crépuscule) de Billy Wilder. Bref, je n'ai pas décroché de mon rôle pendant trois mois.
M.H.- De temps en temps, on réalisait qu'on était à la Warner et que c'était quelque chose d'incroyable. Nous avons tourné le film en 35 jours, ce qui est très court. Mon obsession était de finir la journée, d'être efficace. En fait, je n'avais pas vraiment le temps d'être lucide sur l'endroit ou j'étais.
J.D. - Moi, au contraire, je me servais du plaisir que j'avais d'être là pour nourrir mon personnage. Dans mon sourire et dans mes rires, il y a aussi le plaisir d'être à la Warner. C'est le mélange des deux qui donne à George Valentin cette tête d'ahuri fier de lui. J'étais très heureux de tourner dans les studios mythiques d'Hollywood. Je parle aussi bien du décor que des figurants. Les photographes, les flics Je m'amusais à tous les regarder. C'est très troublant d'entrer comme ça dans la photographie, dans le cadre, à ce point. Avec en plus la musique en direct. Il y avait un côté schizophrène. Souvent, je me suis dit: «J'y suis ou je le joue?». Derrière la caméra, parfois, je distinguais Michel et les techniciens. Ils étaient tous «habillé 2010». Ils étaient dans le réel tandis que, moi, j'avais vraiment la possibilité de partir dans le film.
M.H. - À Hollywood, Jean étais au paradis, et moi je vivais un peu l'enfer. Je devais organiser l'image du film, au jour le jour, suivre un plan de travail draconien. J'étais à Hollywood pour faire revivre le lustre de ces années-là. Pas pour en jouir. De fait, mon travail était compliqué. Laborieux à mettre en place. Quand quelque chose n'allait pas, tout freinait. C'est d'ailleurs l'une des rares fois où je me suis énervé sur un plateau sur les gens de l'équipe américaine de la production. J'ai toujours essayé de protéger les comédiens pour qu'ils se sentent en confiance.

Quel était votre degré d'entente sur le plateau?
J.D. - Nous nous faisons totalement confiance. Michel a écrit le film pour Bérénice et moi. A priori, nous avions juste à faire notre travail. Le fait qu'on se connaisse bien tous les trois nous a fait gagner du temps.
Le plateau de tournage des studios Warner s'est-il transformé en «village gaulois»?
M.H. - Oui et non. Au bout du troisième jour, nous avons tourné sur Sunset Boulevard. Là, le village gaulois a volé en éclat. Il n'y avait plus qu'une équipe de cinéma qui fait un film. Et surtout, un film muet qui fait exploser toutes les barrières. Celle du langage et celle de l'image. Tout ce qu'on faisait était compréhensible par les Américains. Un langage commun s'est installé peu à peu. Bien sûr, aux États-Unis, l'organisation du travail est différente. Les Américains de l'équipe n'avaient jamais vu un réalisateur cadrer son plan, tout seul. Ils ont fini par s'habituer. Ils ont fini par respecter nos méthodes.
J.D. - Il faut tout de même préciser que les acteurs à Hollywood ne restent pas sur le plateau, ils vont dans leur loge. Nous, on rigolait ensemble. Au début, ils ne comprenaient pas trop cette familiarité.
M.H. - L'organisation du travail n'est pas la même, certes. Mais il s'est passé quelque chose de très fort autour du film.
Cette expérience américaine vous a-t-elle donné l'envie de recommencer?
J.D. - Dans ce cadre là, oui; c'est l'idéal.
M.H. - Une production française tournée avec des moyens américains! J'avais le plus beau des jouets!
Quelle est la scène du film la plus poétique selon vous?
J.D. - Pour moi, c'est la séquence où George Valentin, star déchue du muet, se revoit soudain en smoking, face à la devanture d'un magasin de vêtements, grâce à un reflet dans la vitrine.
M.H. - L'avantage d'un film muet, c'est que vous êtes dans une représentation qui ne cherche pas à singer la réalité. Nous tournons le dos à la réalité pour aller vers des scènes oniriques. Certaines séquences s'échappent de la réalité délibérément: par exemple, quand l'ombre du héros s'en va. Ou bien lorsqu'un mini George Valentin apparaît sur le comptoir du bar. Ce sont ces trouvailles merveilleuses qui m'ont intéressé dans tous les films que j'ai regardé avant de faire le mien.
Jean Dujardin et Huggy. (Warner Bros)
Parlez-moi du petit chien, Huggy, qui a remporté la «palme dog» à Cannes
J.D. - Huggy appartient à la silhouette de George Valentin. Ils sont indissociables. Parfois, il me suivait. Parfois je devais le suivre aussi. Il fallait s'arranger comme ça.
M.H. - C'est vrai que la silhouette d'un personnage et son chien semble familière dans le cinéma de l'époque. Je comprends maintenant pourquoi on m'a souvent dit qu'il ne fallait pas tourner avec des animaux et des enfants. La performance du chien n'a aucune valeur sans celle de l'acteur. Lorsque le chien mord le pantalon de George Valentin parce que celui-ci veut se tirer une balle dans la tête, le secret de cette séquence tient au fait que nous avions fourré des saucisses sous le pantalon de Jean. Il voulait sa saucisse, le chien! Finalement, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire que le chien joue bien. Cela veut dire qu'on lui prête des sentiments, donc que j'ai bien travaillé. Lors de la préparation du film, on m'a emmené voir les stars du dressage animalier. Je n'ai rien trouvé. En désespoir de cause, je me retrouvé chez un petit dresseur qui avait trois chiens, dont le Jack Russel que je recherchais. La surprise, c'est que ce chien, Huggy, savait tout faire.
Cela ressemble un peu à la complicité entre Tintin et Milou
M.H. - Tout à fait. D'ailleurs, j'aime le décalage entre la fabrication du film et ce que les gens ressentent ensuite. Nous ne l'avons pas vécu de la même manière, croyez-moi (rires).
Ce film est un vibrant hommage à Hollywood et aux films qui vous ont fait rêver. Comment s'est passée l'écriture du film?
M.H. - L'écriture a été pénible, même s'il y a eu quelques moments jouissifs où on croit avoir trouvé un gag visuel ou une belle transition. Ces petits moments-là ont alterné avec de longs moments plus pesants.
D'où vient l'idée de faire jouer Bérénice Bejo avec la manche d'une veste comme si elle animait une marionnette?
#SundayFunday Have you ever seen a #duck taking supplements? Well, guess what, they do! 🦆 This cutie shows how to t… https://t.co/e0FD2oLQ8l
— NHV Natural Pet Sun Mar 08 16:56:04 +0000 2020
M.H. - D'un film de Frank Borzage, L'Heure suprême. Mais Bérénice l'a réinventé à sa manière. La clé du succès pour ce genre de séquence, c'est de demander à l'acteur de construire lui-même l'image et de la mettre en scène. Sinon, tout ça fait très fabriqué.
La scène finale avec le numéro de claquettes fait penser à Chantons sous la pluie
J.D. - Nous avons travaillé presque un an dessus. C'est beaucoup mais ce n'est jamais assez. On ne peut pas faire semblant de danser. Nous étions sans arrêt ballotté entre la technique, le plaisir, l'allure. Je me disais: «Décrispe toi, détends toi, ne pense plus aux claquettes, écoute la musique, amuse toi. Ne fais des claquettes: danse!» Cette scène, c'est le happy end. Il ne fallait pas se rater.
M.H. - C'est un happy end à l'américaine. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très touchant à voir des acteurs apprendre par cœur quelque chose en vue d'un spectacle. C'est la même chose que le spectacle de fin d'année de vos enfants. La même démarche. Bérénice et Jean ont beaucoup travaillé
Combien y a-t-il eu de prises sur cette scène?
M.H. -Treize! Je n'ai voulu faire que trois plans larges pour voir leur corps danser, sans découper les prises. Du coup, Bérénice et Jean ont eu une grosse pression. J'avais en tête une phrase de Fred Astaire qui disait: «C'est soit la caméra qui danse, soit moi, mais pas les deux».
Le parallèle avec Chantons sous la pluie, qui raconte aussi le passage du muet au parlant est-il assumé?
M.H. - Disons que j'ai fais attention à ne pas regarder Chantons sous la pluie pendant l'écriture du scénario. Parce que je savais que c'était le même thème. Si le fond historique est le même, je pense que les deux films sont très différents parce que les intrigues n'ont rien à voir. Le passage du muet au parlant a été un événement très important. Pourtant, il y a eu peu de films sur le sujet.
Dans un film muet, et en noir et blanc, la musique est primordiale. Comment celle de The Artist a-t-elle été composée?
M. H. - Dans un film sans parole, la musique part de loin. C'est 50% du film. Dès l'écriture du scénario, j'ai donné au compositeur Ludovic Bource la musique que j'écoutais pour qu'il s'en imprègne: Bernard Herrmann, Leonard Bernstein, Alfred Newman, Max Steiner, tous les grands compositeurs des classiques hollywoodiens, même s'ils sont postérieurs à la grande époque du muet. C'est ce qui a bercé l'écriture du film tout comme le jazz de l'époque, Louis Armstrong, etc. Ludovic a fait un énorme travail car ce n'est pas un musicien classique.
La bande-annonce:
Comment vous êtes-vous arrangé pour que la musique accompagne à ce point les émotions des comédiens?
M.H. - Pendant le tournage, il y avait aussi de la musique. Je faisais disc jockey. J'essayais de donner une couleur émotionnelle aux acteurs pour les aider, les mettre dans l'ambiance. Les réalisateurs de muet faisaient cela aussi. Des orchestres jouaient sur les plateaux. Au montage, j'ai donné à Ludovic ce qu'on écoutait sur le plateau. Ensuite, j'ai découpé le film en dix blocs narratifs. Son énorme travail a été d'exprimer sa sensibilité, de rester dans une certaine couleur de musique hollywoodienne tout en respectant le récit. C'est très précis, notamment lorsque les personnages jouent des ruptures. Si la musique marque la rupture avant le jeu de l'acteur, celui-ci est affaibli. Ça devient un pléonasme. De ce point de vue, mon travail a été déterminant. J'étais le garant du récit, rappelant à Ludovic lorsqu'il devait se tenir prêt ou laisser l'acteur jouer. Une fois que l'acteur a donné l'information, la musique nous accompagne, mais pas avant.
À la fin du film, n'y a-t-il pas une référence explicite à un thème de Bernard Herrmann?
M.H. - C'est en effet la musique de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Bien vu! Ou entendu, devrais-je dire
Quelles indications avez-vous données à Guillaume Schiffman sur la lumière?
M.H. - Notre directeur de la photo a fait un travail incroyable de digestion de l'image. À un moment donné, il faut oublier tout ce qu'on a appris pour raconter sa propre histoire et, ensuite, être au service d'un metteur en scène sans oublier d'exprimer sa propre sensibilité. Par exemple, je lui ai dit que je voulais des lumières typiquement années 40 même si ce n'est pas la même époque. J'en avais besoin pour raconter l'histoire. Sur un plateau, je suis assez directif. Mais c'est à l'intérieur de ces contraintes que le compositeur et le directeur de la photographie ont pu réussir à trouver leur liberté.
The Artist n'est-il pas un hallucinant pari, réussi au delà de vos espérances?
M.H. - Moi j'espère toujours beaucoup! Mais je me suis rendu compte que j'étais très mauvais pour parier sur le succès. Depuis longtemps, mes seuls moteurs sont l'envie et le plaisir. J'avais envie de faire The Artist depuis longtemps. Après, la chance consiste à rencontrer des gens comme Jean Dujardin et Bérénice Bejo, et un producteur tel que Thomas Langmann qui dit: «OK, allons y!».
Quand l'avez-vous rencontré?
M.H. -Thomas m'a contacté le premier en me proposant de faire un film avec lui. Il m'a parlé de son projet autour de Fantômas. Cela a réveillé mon envie de faire un film en noir et blanc à la manière des films de Louis Feuillade. L'idée l'amusait. Mais le financement n'a pas suivi. Je lui ai dit: «Attend que j'ai une histoire». Quand je lui ai fais passer le script, il a adoré et a dit: «Banco!». Avec Jean j'ai été très prudent, j'ai écris le film pour lui. Je lui ai fait lire en premier. Il aurait pu refuser. Je pense qu'il y a une forme d'inconscience ou d'insouciance au départ de tout film. Thomas Langmann a un truc d'enfant capricieux que j'adore, le respect très fort de son désir. S'il désire vraiment quelque chose, il se donne les moyens de le faire. Il m'a fait confiance du début jusqu'à la fin. C'est une chance énorme.
Jean Dujardin producteur, c'est une nouvelle aventure?
J.D. - C'est la continuité de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici. C'était une grosse envie de revenir chez moi, revenir à ce que j'aime faire, la comédie, dans un concept et un format original. Après un film muet, je peux bien faire un film à sketchs, non? Les Infidèles sortira le 29 février 2012. J'ai eu envie de rassembler des gens avec qui j'avais travaillé, de trouver un thème.
De quoi s'agit-il?
J.D. -C'est un film qui rappelle la comédie italienne et plus précisément Les Monstres, réalisé en 1963 par Dino Risi. L'idée était un peu de se moquer de nous-mêmes, les hommes. Nous sommes des animaux. Gilles Lellouche et moi avions envie de les observer. On commence la promo, c'est effrayant.
Faites-vous partie de l'aventure Michel Hazanavicius?
M.H. - Oui. J'ai réalisé un des sketchs.
J.D. - Il y a aussi Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Jan Kounen, Alex Cortes et Éric Lartigau. Le film compte sept sketchs en tout. C'est à la fois très attaquable et très inattaquable.
Pourquoi?
M.H. - Parce que les films qui fonctionnent à l'envie sont très sincères.
J.D. - L'idée était de voir plein de films en un seul. Il n'y a que le film à sketchs pour ça: autant de gueules, de personnages et autant d'émotions. Je me suis dit que ça convenait bien à l'époque aussi, le fait de consommer un film à sketchs
La critique vidéo - «Muets devant l'audace de The Artist»:
À quand le retour d'OSS 117?
M.H. - Quand l'envie sera là et plus forte que pour d'autres films. Aujourd'hui, il n'y a pas de date prévue. Tous les gens qui ont participé au premier et au second adorent ce personnage et seraient partant. L'idée est avant tout de faire un film différent des autres. En ce qui me concerne j'ai besoin d'un peu de temps pour retrouver une fraîcheur, une bonne idée. Je pense que si on le faisait maintenant il serait trop proche des deux premiers. Le faire parce que les gens l'attendent n'est pas une bonne raison. Tout le monde attend tellement le thème frelaté de la «Françafrique» qu'il faudra trouver autre chose. Il faut à la fois répondre à l'attente du public et faire quelque chose de complètement nouveau. Si vous faites ce que les gens attendent, ils sont très déçus. Ils ont la sensation qu'ils auraient pu le faire. Bref, c'est compliqué!
J.D. - Il faut créer l'envie et trouver l'idée. Sinon ça va «ronfler». De toute façon je vais vieillir. Donc, OSS sera plus vieux. Si on le refaisait un film maintenant, notre pauvre espion aurait une sale gueule. C'est vrai qu'avec son appareil photo en bandoulière, dans Rio ne répond plus, il faisait déjà vraiment tâche. Wait and see
LIRE AUSSI :
» Dujardin et Bejo récompensés aux USA!
» The Artist dans la course aux Oscars
» CRITIQUE VIDÉO - Muets devant l'audace de The Artist
» Jean Dujardin: Brice surfe sur la vague du succès