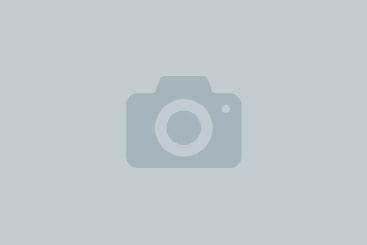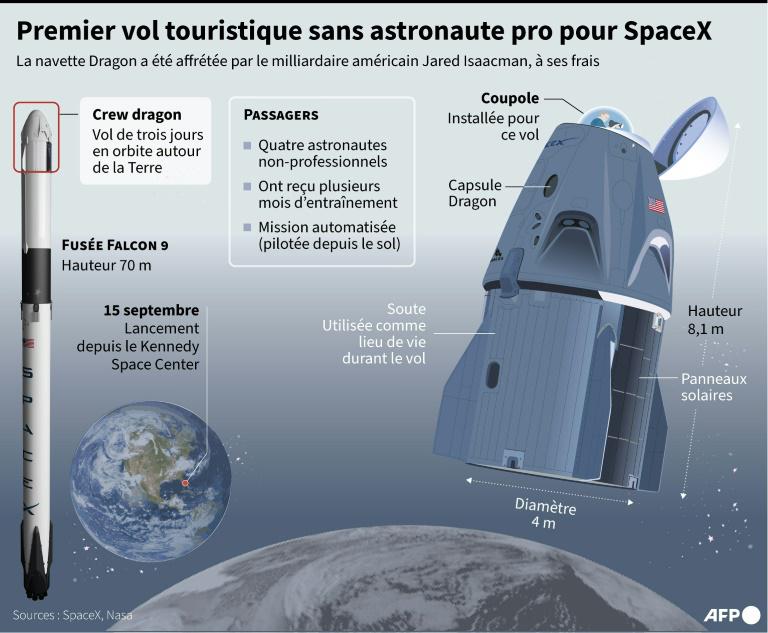«Nous tombions dans un gouffre inconnu»
«On aurait dit que nous étions coincés dans la paume d’un géant qui pouvait nous écraser quand il le voulait, d’un seul geste, en refermant la main.» Ce pays où règne l’arbitraire n’est pas nommé, sans doute présente-t-il quelque ressemblance avec celui qui a mis l’auteur de ce roman en prison. Le héros est un jeune étudiant précipité dans la précarité par la ruine et la mort de son père. Il rencontre une fille de son âge, et de la même condition, qui a foi comme lui en la littérature. Mais il rencontre aussi Mme Hayat, une femme d’âge mûr, à l’enregistrement d’une de ces émissions de divertissement qui requiert des figurants. Mme Hayat lui apprend l’amour, la jouissance de l’instant. Elle qui ne croit pas aux livres, elle sait énormément de choses. Elle est très seule, secrète, il ne sait rien d’elle, prend ce qu’elle lui offre. Loin de s’arrêter à un suspense sentimental − laquelle des deux relations l’emportera ? −, le livre est une très belle méditation sur la peur, la perte, la lucidité. (Claire Devarrieux)
La vie des gens changeait en une nuit. La société se trouvait dans un tel état de décomposition qu’aucune existence ne pouvait plus se rattacher à son passé comme on tient à des racines. Chaque être vivait sous la menace de sombrer dans l’oubli, abattu d’un seul coup comme ces pantins qu’on prend pour cible dans les fêtes foraines.
Ma propre vie avait changé du jour au lendemain. Ou à vrai dire, celle de mon père. A l’issue de divers événements que je n’ai jamais compris, un grand pays ayant décrété «l’arrêt de l’importation de tomates», 1 000 hectares de terrain agricole se transformèrent en une immense décharge rouge. Une phrase donc avait suffi à ruiner mon père, cet homme qui, avec une témérité typique de ceux que leur travail au fond dégoûte, avait investi toute sa fortune dans un seul produit. Au matin d’une nuit agitée, il était mort d’une hémorragie cérébrale.
La violence du choc était telle que nous n’eûmes même pas le temps de porter le deuil. Nous vivions un bouleversement, en spectateurs appliqués et participants attentifs, mais sans réellement réussir à comprendre ce que la mort de notre père impliquait. Une vie que nous croyions ne jamais devoir changer venait de s’effondrer d’un coup, avec une facilité proprement terrifiante. Nous tombions dans un gouffre inconnu, mais la profondeur de ce gouffre, où et quand aurait lieu l’atterrissage, je l’ignorais. Je devais le découvrir plus tard.
De fortune, il nous restait la somme importante que ma mère avait à la banque, produit des 4 000 mètres carrés de serres florales que mon père lui avait offertes pour son «amusement». Ma mère me dit : «Je continuerai à payer tes études, mais tu dois oublier le luxe de la vie d’avant.» A vrai dire, étudier la littérature dans une université lumineuse, au milieu de grands jardins, c’était déjà un luxe ; ma mère, pourtant, refusa catégoriquement d’entendre parler d’abandon.
Mon pauvre père avait voulu que je devienne ingénieur agricole, et moi j’avais insisté pour faire des lettres. Je crois que dans ma décision, au-delà d’une sorte de rêve d’aventureuse solitude au milieu d’un palais bâti en romans, il y avait la certitude qu’aucun de mes choix ne saurait menacer la sécurité de l’avenir qui m’était promis.

Une semaine après l’enterrement de mon père, je pris le bus de nuit pour retourner dans la ville où j’étudiais. Le lendemain matin, je candidatai pour l’allocation d’une bourse. J’étais un bon étudiant ; la bourse me fut accordée.
Je n’avais plus les moyens de payer le loyer du trois-pièces avec grand salon que je partageais avec un ami. Il fallait déménager. Je trouvai une chambre à louer dans un des vieux immeubles d’une rue de la soif où j’allais de temps en temps boire un verre avec mes camarades. C’était un bâtiment de six étages, datant du XIXe siècle, à la façade couverte de grappes violettes et aux balconnets ornés de balustrades en fer forgé. Il y avait aussi un vieil ascenseur en bois entouré d’une cage de fer, mais il ne marchait plus. L’ensemble, jadis, avait probablement servi d’auberge, désormais on y louait des chambres à l’unité.
Après avoir mis de côté les quelques vêtements qui m’étaient nécessaires, je déployai une rage absurde, comme si cela me vengeait de nos malheurs, à vendre pour trois fois rien à des brocanteurs mes livres, mon téléphone, mon ordinateur, puis j’emménageai.
La chambre avait un lit en laiton, à son chevet une vieille commode en bois, à côté de la porte du balcon une petite table ronde fendue en son centre, une chaise, et un miroir accroché au mur près de la porte. Il y avait aussi une douche et un cabinet, de la taille d’un placard. Pas de cuisine. Un grand salon du deuxième étage faisait office de cuisine commune. Une longue table en bois grossier occupait le milieu de la pièce, flanquée de deux autres semblables. Un énorme réfrigérateur de la marque Frigidaire, vieux d’au moins cinquante ans, ronflait dans un coin. Un comptoir aux bords recouverts de faïence blanche, un évier aux robinets en bronze dont les têtes en porcelaine portaient en français les inscriptions «chaud» et «froid», un samovar plein de thé, dont l’eau, étrangement, semblait ne jamais cesser de bouillir, et une télévision : c’étaient les seuls objets en partage dans la grande cuisine commune.
Le balconnet de la chambre était charmant. Je m’y asseyais sur une chaise pour observer la rue aux vieux trottoirs pavés. A partir de 7 heures du soir, elle était bondée. A 9 heures, on ne voyait plus un pavé, une foule bigarrée la recouvrait entièrement, respirant, gonflant et s’élargissant comme un seul et unique corps. Un nuage lourd de senteurs d’anis, de tabac et de poisson grillé montait jusqu’à nous en même temps que les rires, les cris, les braillements de joie. On aurait dit que cette rue, dès l’instant où vous y mettiez le pied, vous faisait oublier le monde extérieur, et vous connaissiez alors l’ivresse d’un bonheur passager. Je suivais de loin cette fête dont j’étais désormais un élément du décor.
Les locataires prenaient leurs repas dans la cuisine. Ils avaient écrit leurs noms sur les boîtes qui remplissaient le frigidaire. Personne ne touchait aux aliments des autres. Un calme et un ordre inouïs régnaient dans cet immeuble peuplé d’étudiants pauvres, de travestis, d’Africains fabriquant et revendant des contrefaçons de marques célèbres, de gamins de la campagne qui couraient après un boulot à la journée, de videurs de bars et autres commis de cuisine qui travaillaient dans les restaurants du quartier. Personne ne commandait, aucune autorité ne s’imposait, et pourtant chacun s’y sentait en parfaite sécurité. On devinait bien qu’une partie des gens qui vivaient ici, une fois dehors, trempait dans des affaires louches, mais ce dehors-là n’entrait pas dans l’immeuble.
Je ne savais pas cuisiner ; faire à manger me répugnait même. En règle générale, je me contentais d’un morceau de fromage et d’une moitié de pain achetés chez l’épicier du coin de la rue. Comme beaucoup de nouveaux pauvres, j’appréhendais tout ce qui m’arrivait avec un mélange d’excès et de malhabileté comique.
Je ne me rendais dans la cuisine que pour boire le thé qui accompagnait mon «repas». J’y découvrais les biceps bagarreurs d’un videur qui se baladait toujours en débardeur noir et préparait des plats ahurissants, qu’il faisait goûter à tous ceux qui se trouvaient dans la cuisine au même moment : steak à l’ananas, bonite au gingembre, ce genre de bizarreries.
L’immeuble était aussi incroyablement sûr qu’il était un nid d’espions, chacun possédant toute une série d’informations sur les autres. C’est ainsi que j’appris, sans presque m’en apercevoir, que mon voisin de palier, un travesti qui s’appelait Gülsüm, était amoureux d’un cuisinier marié, que tout le monde appelait «le Poète» le gars qui habitait à deux chambres de la mienne, que Mogambo, un grand noir qui vendait des sacs à main le jour, faisait le gigolo la nuit, ou que l’oncle d’un des gamins de la campagne avait tué son fils. Comme si les murs de la cuisine murmuraient des secrets.
Je saluais tout le monde, j’échangeais quelques mots avec chacun, mais ne me liais d’amitié avec personne. La seule personne avec qui j’aimais bavarder était Tevhide. Elle avait 5 ans, c’était le seul enfant de l’auberge. Avec ses cheveux bizarrement tondus et ses grands yeux curieux de tout, d’un vert sombre et profond, elle ressemblait à une goutte d’eau. La première fois que je la rencontrai, elle me fit signe du doigt de venir vers elle, et soufflant à mon oreille comme on confie un secret, elle me dit :
— Tu sais quoi, il paraît qu’il y a un chiffre 1500.
— Vraiment ? lui répondis-je en prenant l’air étonné.
— Je te jure, dit-elle, un copain me l’a dit aujourd’hui.
Quand je ne croisais pas Tevhide et son père dans la cuisine, je mangeais mon sandwich au fromage, buvais deux verres de thé puis retournais dans ma chambre, je regardais la rue, puis je feuilletais le dictionnaire de la mythologie que je n’avais pas réussi à vendre. Un trésor d’imagination vieux de milliers d’années m’emportait dans ses histoires de dieux dont le caractère et les aventures n’avaient rien à envier au pire des hommes, dans un univers de guerres infinies, d’amours, de jalousies, de maléfices et d’ambitions dévorantes, et pour un temps j’oubliais le monde tel qu’il était.
L’automne, saison majestueuse et «toute fatale», avait commencé à s’étendre sur la ville. Le temps se rafraîchissait, les cours reprirent.
Un soir, tandis que je dînais dans la cuisine, un type dont je ne connaissais pas le nom me demanda si je cherchais un petit boulot en dehors de mes heures de cours. Il y avait peu d’argent à se faire, mais il était facilement gagné. Je dis «oui» sans réfléchir ; chaque centime comptait, désormais. Il me tendit une carte sur laquelle figurait cette mention : «Les Copains – Figuration». Le lendemain, j’étais à l’adresse indiquée.
C’était il y a un an. A l’époque, j’ignorais encore que la vie est littéralement la proie du hasard et qu’un mot, une suggestion, ou rien qu’une carte de visite, dénués de volonté propre, par le minuscule mouvement qu’ils lui impriment, suffisent à la faire changer du tout au tout.
Ahmet Altan, Madame Hayat, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, Actes Sud, 272pp., 22€, en librairie le 1er septembre.
La semaine prochaine , l’Etrangère d’Olga Merino