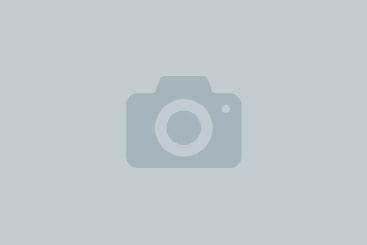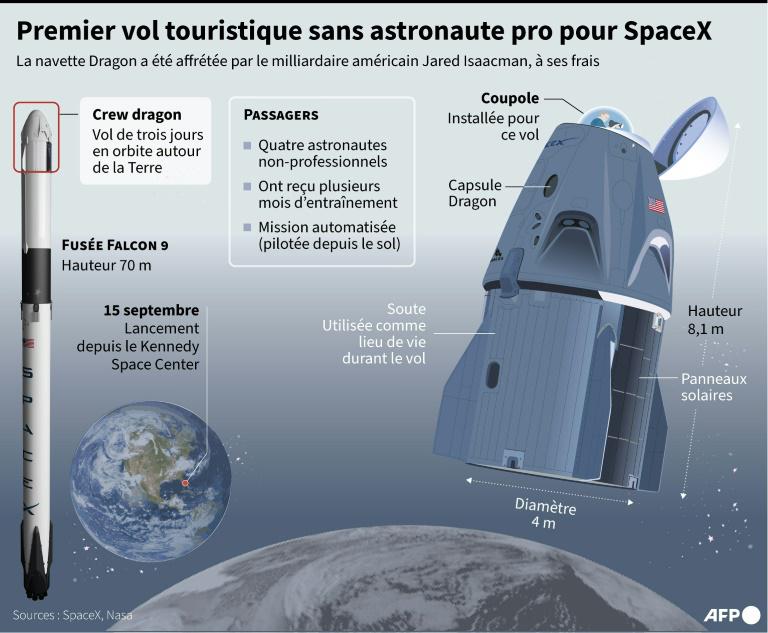Les mots qui libèrent
C’est mal parti. Autour de la table, la petite bande de détenues ne trouvent rien de bon à dire sur le livre qu’elles ont lu ce mois-ci dans le cadre du club de lecture. À tour de rôle, elles prononcent leur verdict. « Long et pénible. » « Sans émotion. » « Une corvée. »
Et pourtant, dans l’heure qui suivra, à force de discussions et de tâtonnements, ces femmes au passé sombre aborderont avec une finesse peu commune les thèmes les plus chers aux philosophes et aux historiens.
Dans une cuisine défraîchie du pénitencier de Joliette qui leur sert de salle de réunion, chacune est munie de son exemplaire de Guerres, un classique de la littérature canadienne-anglaise signé Timothy Findley. Cette histoire de jeunes soldats s’entretuant sous d’infinis ciels gris, pendant la Première Guerre mondiale, les amène à explorer la part d’ombre de la nature humaine. À comparer leur calvaire à celui de ces hommes devenant fous dans les tranchées boueuses. À se demander si, placées dans le même contexte, elles auraient obéi aux mêmes ordres, commis les mêmes massacres. Et si elles auraient su préserver, malgré la barbarie, un bout de leur humanité.
En filigrane se dessine une question qui reviendra souvent, sous une forme ou sous une autre, pendant les heures que je passerai avec elles : portons-nous l’entière responsabilité de nos actes ?
***D’avril à octobre 2016, j’ai assisté à six rencontres du club de lecture de la prison pour femmes de Joliette, près de Montréal, une permission rarissime obtenue au bout d’un an de démarches auprès du Service correctionnel du Canada (SCC). Un soir par mois, elles sont une quinzaine de détenues, de tous âges et de tous antécédents, à se réunir pour échanger leurs impressions sur le livre choisi, en compagnie de deux bénévoles. Depuis la création du club, en avril 2014, elles ont lu de tout : des classiques, des romans historiques, de l’horreur, du Margaret Atwood (un flop), du Mordecai Richler, Le comte de Monte-Cristo, la bédé Paul à Québec, Hunger Games. Elles en discutent dans un calme joyeux, traversé de pointes de tristesse ou d’amertume, mais le plus souvent ponctué de sonores éclats de rire.
Dans un univers carcéral devenu ces dernières années plus écrasant et explosif, ces moments de communion autour de la lecture constituent un sanctuaire. « Sans ça, on ressent les murs se resserrer autour de nous autres. C’est le seul temps où on a l’occasion de se sentir ailleurs que dans une prison », me dit Karine, membre de la première heure. Il existe 29 clubs dans les 43 pénitenciers fédéraux pour hommes et pour femmes au Canada, chapeautés par un organisme de bienfaisance établi à Toronto, Book Clubs for Inmates. Joliette est le seul établissement au Québec où cette activité est offerte.
Partout dans le monde, des gens se mobilisent pour améliorer l’accès aux livres derrière les barreaux. Des clubs de ce genre, on en voit émerger aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Croatie, en Pologne, au Japon. Car la lecture est bien plus qu’une échappatoire pour des prisonniers en mal de distraction : c’est un puissant levier de transformation, un outil remarquable pour les préparer à réintégrer la société et diminuer leur risque de récidive.
Mais au Canada, le manque d’engagement des autorités carcérales menace ces efforts. Dans son plus récent rapport, paru à l’automne, l’enquêteur correctionnel du Canada et ombudsman des détenus expose les profondes lacunes en matière d’accès à la lecture et à l’éducation dans les pénitenciers du pays. Howard Sapers a occupé cette fonction pendant 12 ans avant de devenir conseiller du gouvernement ontarien, en décembre. « La majorité des gens qui purgent une peine fédérale vont un jour retourner dans la collectivité, m’explique-t-il en entrevue. À leur sortie, il faut que leur expérience ait servi à quelque chose et que la sécurité publique en soit renforcée. Ça coûte au-delà de 100 000 dollars pour détenir un homme dans un pénitencier pendant un an, le double pour une femme. On doit s’assurer qu’on obtient le meilleur rendement possible pour cet investissement. »
Une tribu bigarrée
Les femmes qui m’entourent ont tué, fraudé, cambriolé, fait du trafic de drogue, fricoté avec la mafia. Toutes ont écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus (les sanctions plus courtes sont purgées dans les prisons provinciales). Ni moi ni aucun autre visiteur ne peut rester seul avec elles sans être muni d’un bouton d’alerte portatif.
Pour pénétrer dans l’enceinte, j’ai dû passer par le détecteur de métal, me faire ausculter la main à l’aide d’un scanneur à ions, sorte de sonde qui décèle les traces de stupéfiants, et rester immobile pendant qu’un maître-chien guidait son beagle renifleur autour de moi.
Pourtant, une fois assise à leurs côtés, dans la cuisine aux murs vert pomme qui pourrait être celle d’un centre communautaire, j’en viens à oublier que je suis « en dedans ». Il m’arrive même de sursauter lorsque j’aperçois par la fenêtre l’imposante clôture en grillage coiffée de barbelés, rappel glacial qu’ici, on est coupé du monde.
Je découvre une tribu bigarrée, plusieurs de ses membres déjà boulimiques de lecture, d’autres qui ne savent pas encore comment s’y prendre pour apprécier un livre. Il y en a des bavardes, d’autres plus éteintes, des élégantes, des boudeuses, des ricaneuses. Marie-Ève*, femme pensive au teint blême mais à l’œil vif, aime soulever des réflexions existentielles et citer les passages poétiques qu’elle a soulignés. Johanne*, la mi-quarantaine hargneuse et tatouée, manquera quelques réunions lorsqu’elle sera envoyée au « trou », c’est-à-dire en isolement dans une cellule 23 heures sur 24. Sonia*, amatrice de contes de chevaliers et de princesses, porte sur son visage les marques d’une vie rude et n’a pas tous les mots pour exprimer les pensées qui déboulent de sa bouche édentée. Il y a aussi Clara*, le début de la vingtaine, une humoriste en puissance qui aurait ce qu’il faut de vivacité pour partager la scène avec Louis-José Houde. Danielle*, femme d’âge mûr à la posture fatiguée, férue d’histoire et de généalogie, qui se présente parfois avec des notes griffonnées sur une feuille. Et l’incontournable Christine, la matriarche et leader du club de lecture, dont le regard malicieux abrite un puits de tristesse.
Elles m’intègrent dans leur mécanique bien rodée. De ses débuts me dit-on chaotiques, le club de lecture est devenu une affaire structurée, avec des tours de table où chacune a l’occasion de s’exprimer ; des questions qu’on écrit sur des bouts de papier et qu’on pige pour stimuler la discussion ; des incitations constantes à écouter sans interrompre. « J’ai vu changer beaucoup le caractère de certaines femmes, qui étaient braquées en arrière d’une armure », me dira Karine.
***Les détenues des cinq pénitenciers pour femmes du pays — elles sont environ 700, dont 115 à Joliette — sont parmi les êtres les plus écorchés de la société. Broyées, encore plus que les hommes, dans l’engrenage de la violence, de la maladie mentale et de la misère.
Pas moins de 86 % d’entre elles ont vécu de la violence physique, et 68 % des sévices sexuels, selon les plus récentes données du Service correctionnel et du Bureau de l’enquêteur correctionnel. La moitié présentent des problèmes de santé mentale — deux fois plus que chez les détenus masculins — et près de une sur deux prend des médicaments psychotropes. En fait, presque toutes (94 %) ont souffert d’au moins un trouble psychiatrique au cours de leur vie — notamment du syndrome de stress post-traumatique, dont 52 % des détenues ont été atteintes. Plus des trois quarts sont toxicomanes ou alcooliques. Une bonne moitié se sont déjà infligé des blessures ou ont essayé de mettre fin à leurs jours.
Des spécialistes parlent volontiers de « criminalité de survie » pour expliquer la déroute de ces êtres carencés. Au moment d’entrer au pénitencier, les deux tiers n’avaient pas terminé leurs études secondaires et 60 % étaient sans emploi. La majorité sont aussi mères : plus de 70 % des prisonnières ont des enfants de moins de 18 ans, le plus souvent en situation monoparentale. « Une criminalité de survie, c’est un choix par manque de choix. Tu es dépendante de l’alcool ou des drogues, tu as besoin d’argent, tu es plus à risque d’être en conflit avec la loi, ne serait-ce qu’en faisant de la prostitution ou en volant. Et là, tu es prise dans une spirale », m’explique Ruth Gagnon, directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Québec, un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes judiciarisées. « Il y en a qui, à peine sorties de l’enfance, étaient déjà marquées pour le restant de leur vie. »
Dérapage contrôlé
Lors de ma deuxième présence à la prison, fin avril, ces brutales réalités ont fait irruption dans le club de lecture, et ont failli tout faire sauter.
Un roman d’une violence insoutenable est au programme ce soir-là : Une fille comme les autres, de Jack Ketchum, un thriller qui raconte l’histoire d’une adolescente torturée à mort dans le sous-sol d’une maison de banlieue, aux États-Unis, dans les années 1950. L’auteur ne ménage pas les détails sur les supplices physiques et sexuels infligés à la jeune Meg par sa tante désaxée, Ruth, et ses trois fils. L’idée que de telles atrocités soient inspirées de faits réels, que le voisin de 12 ans y ait assisté sans intervenir, que toute une collectivité ait feint de ne pas savoir, tout cela touche ici des cordes trop sensibles.
L’atmosphère est chargée, presque solennelle, dans le petit local. J’en vois qui sèchent des larmes furtives, d’autres qui regardent dans le vide ou qui se frottent les yeux ; les voix sont plus étouffées que d’ordinaire. Plusieurs évoquent les mauvais souvenirs que le roman réveille : la maltraitance subie dans l’enfance, les appels à l’aide restés sans réponse. Certaines vont jusqu’à remettre en question leur participation à l’activité. « J’étais assez en tabarnak que je voulais lâcher, dit Manon*. Quand je lis, c’est un loisir. Ça, là, ça m’écœure pis j’ai pas le goût d’en parler pendant une heure. Ça m’a revirée à l’envers. »
À mi-chemin de la rencontre, Caroline*, n’en pouvant plus de se contenir, se dirige vers la porte : « Je suis mieux de sortir avant de dire de quoi qui risque de blesser des oreilles. » En larmes, Cindy* lui emboîte le pas presque aussitôt : « Y a des choses qui sont arrivées à mes enfants qui sont similaires, pis je suis comme pus capable. » Jamais un livre n’a provoqué un tel émoi depuis les débuts du club.
Une animosité gronde sous la surface. Des sous-entendus accusateurs, lancés sur un ton de défi. Des menaces voilées. « On est assises à une table, dans un pénitencier, pis on vit avec des gens comme ça, fulmine Johanne*. On s’entend-tu que, dehors, ma voisine ferait ça, elle mangerait une méchante culbute ? »
Ce n’est que plus tard que j’ai compris de quoi il retournait, quand Fanny Derouin, coordonnatrice des bénévoles, qui a assisté à la scène, m’a fait une révélation. Assise à la table, parmi les membres du club de lecture, il y a une femme — elle ne m’a pas dit laquelle — qui a violenté des enfants.
La tension a pourtant fini par se désamorcer. Tout en faisant le procès de l’abominable tante Ruth, les détenues se sont mises à s’interroger sur les racines de sa violence : à considérer quelle maladie, quelle haine de soi, quelle oppression avaient pu la conduire à se déchaîner ainsi sur la jeune fille. « Elle devait être une victime elle aussi, déclare Danielle*. T’as toujours des blessures quand tu infliges des blessures. Elle devait pas s’aimer en tant que femme pour essayer de bannir celle qui était en train de grandir devant elle. » Toutes n’étaient pas toujours d’accord. Mais peu à peu, ce qui s’annonçait comme une séance houleuse s’est mué en une démarche d’analyse remarquablement posée.
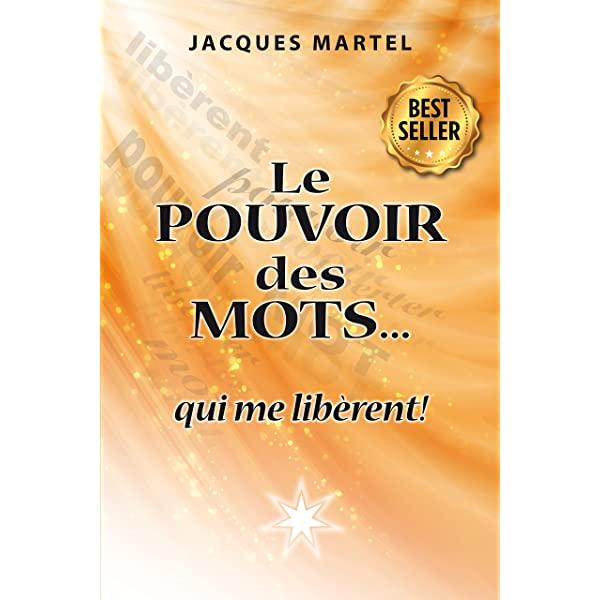
Ce pouvoir des mots de panser certaines plaies, Karine me le résumera ainsi lors d’un tête-à-tête à la prison, quelques semaines plus tard : « Chaque émotion qu’on porte en nous, chaque dégueulasserie qu’on sait pas comment extérioriser, à travers les personnages des romans on est capable de l’évacuer, fait qu’on grandit. »
***Un dérapage a néanmoins été évité de peu, et l’épisode a fait réagir en haut lieu. Qu’un livre puisse raviver des traumatismes ou nourrir des conflits n’a rien d’anodin dans un environnement aussi volatil. « Notre travail, c’est aussi de nous assurer que les femmes sont en sécurité », m’explique Fanny Derouin. Certaines détenues peuvent exprimer leur rage et leur désespoir en se tailladant la peau, en avalant des objets coupants, en s’étranglant avec des ligatures, en se frappant la tête contre les murs. Dans l’ensemble des pénitenciers pour femmes, les « comportements d’automutilation de plus en plus sérieux, chroniques et presque mortels » se répandent, signale l’enquêteur correctionnel dans son dernier rapport, déplorant que les établissements soient mal équipés pour traiter les « délinquantes présentant de graves troubles de santé mentale ». En 10 ans, le nombre d’épisodes d’automutilation chez les détenues s’est multiplié par sept, tandis que le nombre de tentatives de suicide a plus que triplé, selon les chiffres que m’a fournis son bureau. Les voies de fait entre prisonnières sont deux fois plus fréquentes aujourd’hui qu’il y a une décennie.
Ainsi, depuis ce fameux soir d’avril, le club de lecture suscite une certaine nervosité à Joliette. Désormais, chaque livre sélectionné doit être parcouru à l’avance par l’agente des programmes sociaux et approuvé par la direction, précise la directrice, Cynthia Racicot, « pour s’assurer qu’on est disponibles pour les détenues qui auraient besoin de soutien ».
La fée Christine
Le mois suivant, quand j’ai interviewé Christine, la détenue responsable du club de lecture et de la bibliothèque, l’idée que l’activité puisse être en péril l’a amenée au bord des larmes. « J’y tiens beaucoup. C’est mon bébé », me dit-elle en s’essuyant les yeux, dévoilant une vulnérabilité que je ne lui ai pas vue souvent. C’est elle qui recrute les membres, qui prend les présences et qui dirige les échanges avec l’autorité d’une institutrice. C’est elle aussi qui choisit les titres, un peu à tâtons, sur la base des suggestions d’autres femmes, de bénévoles ou d’employés ; une liste est envoyée à Book Clubs for Inmates, qui achète des exemplaires flambant neufs pour chacune des participantes.
À l’aube de la soixantaine, Christine a déjà passé 12 ans à Joliette, et il lui en reste au moins 3 avant d’être admissible à une libération conditionnelle. « Fait que je suis ici pour très longtemps. Et ça me tente pas de passer toutes mes années à ne rien faire ou à juste m’occuper de moi-même. » Or, quand elle a commencé à réclamer plus de livres pour la bibliothèque et à faire des démarches pour mettre un club sur pied, il lui a fallu vaincre le scepticisme du personnel carcéral, raconte-t-elle. « Je me suis fait dire que j’étais utopique. Le SCC ne croyait pas tant aux activités littéraires, auparavant. Ils pensaient plutôt que les femmes devaient répondre à leurs besoins fondamentaux. Mais un besoin fondamental, c’est aussi d’ouvrir ton esprit. » La suite lui a donné raison.
Le goût de la lecture s’est répandu comme un virus, dit-elle, bien au-delà des 15 membres du club. Au moins une douzaine de détenues sont inscrites sur une liste d’attente pour en faire partie (d’où le règlement appliqué à la lettre : deux absences non motivées ou deux lectures non terminées entraînent l’expulsion). L’affluence bat des records à la bibliothèque, pour atteindre une centaine de visites chaque semaine. « Les filles qui sont membres en parlent aux autres, ces filles-là veulent savoir la suite, viennent voir si on a d’autres livres du même genre. La majorité des femmes ici n’étaient pas capables d’aller chercher dans les bibliothèques à l’extérieur. Maintenant, je vois que les gens s’intéressent à des sujets auxquels ils ne se sont jamais intéressés avant. »
Vive Marie de l’Incarnation
Personne ne s’attendait toutefois à ce que le choix du mois de mai soulève de grandes passions : une biographie de Marie de l’Incarnation, de l’auteure franco-québécoise Françoise Deroy-Pineau. Ces détenues qui se plaisent à dire qu’elles ont détesté leurs cours d’histoire à l’école allaient sans doute bouder, pensait-on, ce document érudit, truffé de dates et de détails techniques.
Or, plusieurs ont dévoré le récit des aventures de la religieuse née Marie Guyart, figure centrale de la Nouvelle-France et fondatrice des Ursulines de Québec. Les prisonnières ont découvert une héroïne à leur mesure chez cette nonne qui avait été femme d’affaires et mère de famille monoparentale à Tours, avant de se séparer de son fils pour entrer au monastère. Débarquée à Québec en 1639, Marie de l’Incarnation y demeurera cloîtrée pour le restant de ses jours. Mais elle fera tout à partir de cette réclusion : gérer les finances, concevoir les plans d’un nouveau couvent et veiller sur le chantier, étudier les langues indigènes. Entourée de Françaises et d’Amérindiennes tout aussi intrépides, elle bravera le froid, la faim, la tentation du suicide, même, afin que survive la première école pour filles en Amérique du Nord. « Ça fait juste démontrer que les femmes, quand on se tient, quand on met tous nos petits poings ensemble, on a une force inimaginable », dit Karine pendant un tour de table.
Does anyone know how to treat a pinched nerve this shit has me in tears!!!
— Quashia Serrano Tue Apr 08 14:56:36 +0000 2014
Le récit a des résonances particulières pour cette descendante d’Attikameks et de Hurons. « En étant ici, j’ai repris contact avec mes racines, poursuit-elle. Fait que moi, wow, ça m’a donné encore plus de jus, pis ça va me pousser à faire plus de recherches. Je comprends plus les rébellions et les revendications d’aujourd’hui. » Les autochtones sont nettement surreprésentées au sein de la population carcérale : elles comptent pour 36 % des femmes en pénitencier, et elles forment le sous-groupe qui croît le plus rapidement parmi tous les détenus.
Pendant son séjour de trois ans à Joliette, Karine a puisé une nouvelle sérénité dans la spiritualité traditionnelle. La femme de 39 ans a notamment participé à des cérémonies dans la hutte de sudation dressée sur le terrain de la prison, et consulté une aînée qui travaille comme guide spirituelle auprès des détenues des Premières Nations. Ce soir, à quelques semaines de sa libération, elle porte un « bracelet de guérison » orné de perles colorées, symbole de son cheminement. La prochaine fois que je la verrai, ce sera « dehors ».
***Karine n’est pas la seule à avoir l’humeur à la fête en cette soirée douce qui annonce les chaleurs de l’été. Pour clore la deuxième année du club de lecture, Christine a décerné des « certificats de mérite » à six des membres les plus assidues, sous les applaudissements et les bravos du groupe. « Vous pouvez les remettre aux commissaires [de la Commission des libérations conditionnelles], leur explique-t-elle. Pour montrer que vous avez été capables de participer à une activité sans être payées, sans être obligées par votre équipe de gestion de cas. » Elle avait cuisiné un gâteau aux carottes, qu’elle nous a distribué sur des morceaux de papier absorbant ; du café a aussi été servi, un luxe rare.
La modeste cérémonie a répandu une onde de jubilation autour de la table. Rarement ai-je trouvé les femmes aussi radieuses que ce soir-là, aussi souvent gagnées de fous rires, aussi joyeusement cacophoniques. La sinistre clôture barbelée, dehors, a paru pendant un moment plus lointaine. Le bourdonnement nasillard des haut-parleurs diffusant des appels, en fond sonore, a semblé quelque peu s’assourdir.
Des efforts à récompenser ?
Il y a des endroits dans le monde où les prisonnières auraient reçu plus qu’un diplôme de papier pour leurs efforts. Dans certains pays, la lecture en milieu carcéral est si valorisée qu’elle permet aux détenus d’alléger leur peine. Au Brésil, depuis 2012, les prisonniers fédéraux peuvent écourter la leur de quatre jours pour chaque livre lu et résumé dans une dissertation, jusqu’à concurrence de 48 jours par an. En France, une réforme adoptée en 2014 prévoit des remises de peine pouvant atteindre deux mois pour les détenus qui rédigent des comptes rendus de leurs lectures.
Aux États-Unis, des criminels peuvent même éviter le bagne s’ils s’inscrivent à un programme de 8 à 12 semaines sur la littérature, animé par un professeur d’université, un juge et un agent de probation. Fondé en 1991 au Massachusetts, Changing Lives Through Literature existe aujourd’hui dans une dizaine d’États. Ce sont surtout des délinquants au passé lourd, considérés comme à haut risque de récidive, qui sont sélectionnés pour y prendre part. Et tout indique que ça fonctionne.
Des sociologues en ont évalué les résultats dans le cadre d’une étude publiée en 2013 dans la revue Journal of Offender Rehabilitation. Ils ont examiné les dossiers criminels de plus de 1 200 contrevenants en liberté surveillée, la moitié ayant participé au programme, les autres non. Ceux qui l’avaient suivi ont eu moins tendance à récidiver dans les 18 mois subséquents que ceux qui n’y avaient pas adhéré : leurs délits ont été non seulement moins nombreux, mais moins graves.
Quelques heures à causer littérature peuvent-elles vraiment transformer des criminels endurcis ? Aucune étude contrôlée n’a encore été menée sur les clubs canadiens, mais le modèle qui les a inspirés, au Royaume-Uni, a fait l’objet d’un examen en profondeur. L’organisation Prison Reading Groups, rattachée à l’Université de Roehampton, à Londres, chapeaute plus de 40 groupes du genre dans les prisons du pays. Le rapport, paru en 2013, fait état d’un vaste éventail de répercussions positives chez les détenus — de l’empathie à la littératie, de l’aptitude à communiquer à l’estime de soi en passant par le sentiment d’appartenance et la capacité d’introspection.
***Lors d’un de mes passages à la prison, j’ai demandé aux principales intéressées de me décrire le rôle que jouait le club de lecture dans leurs vies. Ce soir-là, nous avions débattu du roman Sur le seuil, de Patrick Senécal, spécialiste québécois de l’horreur qui compte de ferventes admiratrices au sein du groupe. Dans ce suspense sanglant, un psychiatre ultra-cartésien est forcé de reconsidérer ses certitudes en présence d’un patient qui semble possédé par des forces maléfiques. Peu à peu, le médecin laisse entrer le doute dans son esprit, s’approche d’un seuil qu’il n’aurait jamais cru franchir. Pour les membres du club de Joliette, la lecture, c’est un peu ça : une clé qui ouvre en elles des portes insoupçonnées.
Ce ne sont pas que les mots sur les pages qui décadenassent les esprits. C’est aussi le fait d’en discuter en groupe et d’être placées devant des points de vue divergents. « J’aime ça les discussions, parce que ça m’ouvre à d’autres opinions, à une autre vision du livre. Des fois, ça peut aller jusqu’à me pousser à le relire », dit Delphine*. Et puis, en se forçant à venir à bout d’ouvrages qu’elles n’auraient pas choisis, plusieurs se découvrent des ressources qu’elles ne se connaissaient pas. « Aujourd’hui, je mène mes choses jusqu’au bout », poursuit Delphine, qui s’est aussi mise à l’écriture de chansons. « Peut-être que j’avais un stéréotype, comme si en prison on était toutes des caves. Mais je nous trouve studieuses, brillantes », souligne fièrement Sophie*, jeune femme coquette au parler franc, que j’ai vue s’épanouir au fil des rencontres. « Le club de lecture, ça me permet de voir qu’il y a d’autre chose dans la vie que la consommation », dit simplement Josiane*.
Petit à petit, à force d’exercer cette souplesse mentale, de concevoir d’autres destins, d’autres regards, de nouvelles manières d’être et de penser, elles commencent à se réimaginer elles-mêmes. « Les filles du pénitencier, on est tellement trop restées sur la même note dans notre vie que des fois, sortir de notre zone de confort pis voir les choses d’un autre angle, ça nous ouvre d’autres horizons, pas juste dans la lecture, mais dans notre vie en général », témoigne Emma*, loquace jeune femme aux longs cheveux et aux ongles peints. « Parce que si t’es capable de le voir avec un livre, t’es capable de le voir avec ta vie. » Si bien que la majorité des participantes se promettent de se joindre à un club semblable une fois dehors.
Quand j’ai revu Karine, cinq mois après sa sortie de prison, alors qu’elle séjournait à la maison de transition Thérèse-Casgrain, à Montréal, la confiance acquise dans le groupe ne l’avait pas quittée, ni l’éclat qui l’anime quand elle évoque son amour des livres. « Ça m’a amenée à dépasser mes limites, me dit-elle. Ce qui me reste, c’est qu’aujourd’hui je suis capable de m’exprimer, de m’affirmer, de prendre une certaine place, à laquelle j’ai droit. Si je suis capable de donner mon opinion dans un club de lecture, je suis capable dans d’autres domaines. Que ce soit au travail, dans ma vie personnelle, dans ma fraternité des narcotiques anonymes, dans tout. » En liberté conditionnelle pour encore quelques années, Karine vit aujourd’hui en Estrie, où elle partage son temps entre la lecture, le bénévolat et la recherche d’emploi. Elle a même proposé son aide à deux bibliothèques de sa région pour y démarrer un club de lecture.
L’héritage Harper
La patronne du pénitencier de Joliette, Cynthia Racicot, semble désormais gagnée aux bienfaits de cette activité. L’éveil au plaisir de lire peut, selon elle, aider les femmes à poursuivre leur parcours scolaire et les préparer à occuper de meilleurs emplois, des remparts essentiels contre la criminalité. Leur capacité d’entrer en relation avec les autres et de gérer les conflits s’en trouve aussi améliorée, constate la criminologue de formation, rencontrée dans une salle de conférences de l’établissement. « Ça brise l’isolement, poursuit-elle. Puisque ce sont souvent les mêmes femmes d’une réunion à l’autre, un lien de confiance s’établit, et ça devient possible de se livrer, de parler de leurs émotions, ce qu’elles n’ont peut-être pas été capables de faire auparavant. »
Mais à l’échelle du pays, la place qu’on accorde à la lecture en prison dépend davantage du bon vouloir des gestionnaires d’établissement que d’une politique institutionnelle cohérente. Et tous ne lui réservent pas le même enthousiasme.
Carol Finlay, la pasteure anglicane et ex-enseignante qui a fondé Book Clubs for Inmates, en 2009, confie que les autorités carcérales lui donnent parfois du fil à retordre. Chaque fois qu’elle veut introduire un club dans un pénitencier, il lui faut convaincre la direction du bien-fondé de son travail, de nouveau se plier à de lourdes formalités administratives, et affronter une certaine suspicion. « Je ne vous dis pas la difficulté, la bureaucratie ! m’avoue-t-elle. Nous ne sommes pas une priorité, parce que les clubs ne font pas partie des programmes correctionnels de base. Ils sont considérés comme un loisir. Mais ceux qui nous connaissent savent à quel point notre travail est directement lié à ce qui est enseigné dans ces programmes, sur la gestion de la colère, notamment. »
Des critiques s’inquiètent à l’idée qu’une telle initiative repose sur un organisme de charité à la situation précaire. Book Clubs for Inmates ne reçoit aucuns deniers publics ; son budget annuel de 165 000 dollars est financé exclusivement par des dons privés. Aux yeux de certains observateurs, sa mission devrait d’abord être la responsabilité de l’État.
Or, une approche plus répressive s’est insinuée derrière les barreaux à mesure que la population carcérale a enflé — elle s’est accrue de 5 % en 10 ans dans l’ensemble des pénitenciers, et de 38 % dans les établissements pour femmes. C’est l’héritage des politiques du gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui ont eu pour effet d’envoyer plus de gens en prison et de les garder enfermés plus longtemps. Pendant ce temps, les ressources consacrées à la réinsertion ont diminué. « Les femmes n’ont pas de quoi bien s’occuper, résume en entrevue Howard Sapers, qui était jusqu’à récemment l’enquêteur correctionnel du Canada. Le Service correctionnel dispose d’un bon répertoire de programmes, mais il est incapable de les fournir à toutes les personnes qui en ont besoin au moment opportun, à cause d’un manque de moyens ou de personnel. » Les dépenses dans l’éducation et la formation professionnelle sont aussi en baisse, ajoute-t-il, alors que les besoins vont croissant.
De plus en plus, c’est la manière forte qui l’emporte. L’enquêteur correctionnel a dénoncé, dans ses deux derniers rapports, le recours excessif au placement en cellule d’isolement et l’augmentation de l’usage de la force envers les détenus (ce qui inclut l’emploi de plus en plus habituel du gaz poivré), y compris pour maîtriser des personnes en crise psychiatrique. Les pénitenciers pour femmes, bâtis dans les années 1990 et 2000, devaient s’éloigner de la prison traditionnelle, grâce à leurs unités d’habitation dotées de cuisines et d’aires communes où les femmes vivent comme des colocataires. Mais ça ne les a pas mises à l’abri de cette poigne endurcie. Dans l’ensemble des pénitenciers, selon les chiffres que m’a transmis le Bureau de l’enquêteur correctionnel, le nombre de cas de recours à la force a grimpé de 51 % en une décennie. Dans les établissements pour femmes, il a bondi de 80 %.
Une auteure taillée en pièces !
Quand elles se présentent à la réunion du club, le dernier mardi du mois, espérant oublier leur quotidien fait de querelles et de manques, les détenues de Joliette ont soif. Soif de substance, de profondeur, d’élévation. Mais le bouquin dont elles doivent discuter aujourd’hui, La vie en grosse, de la Québécoise Mélissa Perron, en est singulièrement dénué. Dans la cuisine devenue étouffante en cette soirée d’août orageuse, elles l’ont taillé en pièces.
Cette chronique des déboires d’une jeune trentenaire obèse, écrite sur le ton de la confidence, se voulait spirituelle. Mais presque toutes les femmes l’ont trouvée d’une désolante vacuité, d’une extraordinaire complaisance. « Un livre d’anecdotes. Y a absolument rien là-dedans, s’impatiente Nicole*, une détenue plus âgée qui anime depuis peu à Joliette un club anglophone. La lecture, c’est très important pour nous. On veut pas perdre notre temps. Quand on s’attend à lire pis à être captivée, on veut s’en aller dans un autre monde que le pénitencier. » Pas cette fois.
Ce qui les met hors d’elles, c’est la tendance du personnage, Daphnée-Rose, à s’apitoyer sur son sort et à attribuer tous ses échecs à son excès de poids, mécanismes qu’elles démontent avec une impitoyable acuité. Clara* mène la charge, et sa verve crue fait s’écrouler de rire la petite assemblée. « Moi, je suis gréyée de cuisses, dit-elle. Je suis pas super-méga-toutoune, mais tabarouette, je suis carrée. Pis quand j’ai lu ça ? Motive-toi ! Va au gym ! Si t’as un ostie de caractère de marde, attends-toi pas à ce que tout aille bien dans ta vie ! Il m’a outrée, ce livre-là. Je l’ai lu sur la toilette pendant un mois. »
Ce refus de prendre la responsabilité de ce qui lui arrive, ça ne passe pas ici.
Des livres dans un sac-poubelle
Les livres ont toujours eu un statut ambigu derrière les barreaux. Il y a quelque chose de subversif dans ces objets qui permettent de s’évader de l’enfermement et de la répression. À travers le temps, les autorités carcérales ont tenté de les contrôler, de les exclure, les ont traités avec méfiance, négligence ou mépris.
Une directive du Service correctionnel du Canada, en vigueur depuis 2007, prévoit que la bibliothèque d’un pénitencier doit fournir des services « comparables à ceux qu’offrent les bibliothèques dans la collectivité », afin de répondre « aux besoins des délinquants en documents récréatifs, culturels, spirituels, éducatifs et informatifs ». Mais la réalité est loin de correspondre à cet idéal.
Les gestionnaires d’établissement n’y accordent pas tous la même importance ni les mêmes budgets. Il y a bien certains pénitenciers qui ont des rayons garnis de plusieurs milliers de volumes et qui emploient un bibliothécaire professionnel. Mais dans bien des cas, dont celui des neuf pénitenciers du Québec, ce sont des détenus seuls qui s’en occupent. Les collections sont souvent vieillottes ; les fonds pour les acquisitions, misérables ; les ouvrages adaptés aux autochtones et aux minorités culturelles, insuffisants ; les heures d’ouverture, minimes. Il y a des endroits qui n’ont aucune bibliothèque à proprement parler ; les livres sont placés sur des chariots qu’on pousse à l’occasion dans les unités. La situation s’est encore détériorée ces dernières années, les compressions budgétaires au Service correctionnel ayant entraîné la fermeture ou l’atrophie des services de plusieurs bibliothèques pénitentiaires.
L’enquêteur correctionnel détaille ces carences dans son rapport 2015-2016, rendu public en octobre. « Malgré les lignes directrices nationales, écrit-il, il y a beaucoup de variations régionales dans la manière dont les bibliothèques de détenus dans les pénitenciers fédéraux sont gérées et financées. » À ses yeux, ces disparités sont « inexplicables et inacceptables ». L’enquêteur exhorte le Service correctionnel à redoubler d’efforts pour promouvoir la littératie derrière les barreaux ; il recommande notamment de « soutenir davantage les clubs de lecture », de nouer des partenariats avec les bibliothèques municipales pour permettre aux détenus d’y faire des emprunts, et de renouveler celles des prisons.
Et en dehors de la bibliothèque ? Ce peut être compliqué de mettre la main sur des bouquins. Le catalogue national, qui permet aux détenus de commander des effets personnels, comprend des téléviseurs, des vêtements, des articles d’hygiène, mais pas de livres. Pour en acheter, ils doivent en faire la demande au personnel responsable des activités socioculturelles. Les prisonniers ne peuvent pas non plus, passé le premier mois de leur détention, se faire envoyer de livres à leur nom par des gens de l’extérieur, exception faite de leurs proches, si la direction y consent. On veut éviter que de la contrebande ou des messages illicites se cachent entre les pages. Ces envois sont pourtant permis aux États-Unis, tandis qu’au Royaume-Uni l’interdit a été levé en 2015, sur ordre d’un juge qui citait le pouvoir rééducateur de la lecture.
Kirsten Wurmann, bibliothécaire de Winnipeg, en a vu de toutes les couleurs dans l’univers carcéral. Depuis une dizaine d’années, elle se rend dans les prisons provinciales et fédérales de l’Alberta et du Manitoba pour y offrir bénévolement ses services, aidant les détenus à faire des choix parmi les caisses de livres qu’elle recueille pour eux. « J’ai vu une prison provinciale où les livres étaient fourrés dans des sacs-poubelles, et les détenus fouillaient dedans pour trouver de quoi lire, raconte-t-elle. Dans une autre, tout ce qu’il y avait pour 800 hommes, c’étaient six étagères de livres à moitié déchirés. » Kirsten Wurmann a mis sur pied, en 2014, le Prison Library Network, un réseau d’une cinquantaine d’amoureux des livres qui font avancer cette cause au pays. À son initiative, la Fédération canadienne des associations de bibliothèques vient d’adopter une déclaration qui défend le droit des prisonniers à la lecture. « Nos principes directeurs, comme la liberté intellectuelle et l’accès à l’information pour tous, ne s’accordent pas très bien avec les principes correctionnels, fait-elle remarquer. On doit apprendre à travailler dans ce contexte. »
La censure ajoute une autre barrière à l’entrée des livres dans l’enceinte. Officiellement, le Service correctionnel interdit tous les documents qui pourraient compromettre la sécurité (notamment, ceux contenant de l’information détaillée sur la perpétration de crimes, ainsi que le matériel haineux, obscène ou susceptible d’inciter à la violence). Mais ces consignes sont interprétées de manière incohérente, et parfois arbitraire, dans différents établissements. Kirsten Wurmann a vu des membres du personnel carcéral rejeter des livres sur la seule base que leur page couverture était un peu olé olé. « Ça n’a ni rime ni raison, dit-elle. Ça dépend de la personne qui les inspecte. »
***La bibliothèque de la prison de Joliette est sans prétention, avec sa collection d’environ 9 000 volumes et son budget d’acquisition situé entre 500 et 1 000 dollars par an, auquel s’ajoutent quelque 300 livres donnés chaque année par des organismes, précise le Service correctionnel. Dans le local lumineux, plus petit qu’une salle de classe, j’ai vu, sur les rayons impeccablement rangés, des romans de Stieg Larsson, Anne Hébert, Michael Crichton, Saint-Exupéry, Françoise Sagan ; des ouvrages sur l’histoire, la politique, la spiritualité ; des recueils de recettes ; un Petit Larousse à reliure brune datant d’un autre siècle. On y trouve aussi deux ordinateurs antiques — sans connexion Internet, proscrite dans tous les pénitenciers —, une imprimante et quelques fougères.
Si ce n’était du sens de l’initiative de Christine, le lieu serait sans doute en plus piteux état. Depuis qu’elle a commencé à y travailler, il y a trois ans, les heures d’ouverture sont passées de trois à neuf par semaine. Épaulée par trois autres détenues, elle a fait le ménage dans l’inventaire désuet, informatisé le catalogue, réclamé des fonds supplémentaires pour les achats. Soucieuse d’amadouer les plus farouches, elle a aussi entièrement repensé l’organisation des rayons, plaçant les ouvrages faciles à lire près de l’entrée, par exemple. Mais en l’absence d’employé affecté spécialement à cette tâche, qui sait ce qu’il adviendra de cet héritage lorsqu’elle sortira de taule, dans quelques années. « Je travaille à passer le flambeau à d’autres femmes », me dit-elle.
Un jour, ce sont peut-être ses œuvres qui trôneront sur une étagère. Car la bibliothécaire au sourire de sphinx écrit des romans : une trilogie, l’histoire d’une fille de bonne famille qui tombe amoureuse d’un mauvais garçon, dont elle vient d’envoyer le premier tome à des éditeurs. Si elle parvient à se faire publier, Christine jure de revenir entre ces murs pour rencontrer ses anciennes compagnes, en tant qu’auteure cette fois.
Peut-on survivre à ce qu’on a été ?
Une fois l’an, le club de lecture reçoit la visite d’un écrivain. En 2015, c’est l’Ontarien Lawrence Hill, auteur d’Aminata, qui s’est déplacé. En ce soir de canicule, les femmes attendent celui qui est devenu la coqueluche du pénitencier : Hervé Gagnon, prolifique auteur de romans historico-fantastiques, connu pour ses séries Vengeance, Malefica et, surtout, Damné.
La rencontre se tient pour l’occasion dans la chapelle, une pièce éclairée aux tubes fluorescents à laquelle des objets hétéroclites — crucifix, capteur de rêves, statue d’ange, fleurs artificielles — n’arrivent pas à insuffler de l’âme. Devant ces femmes qui l’acclament avec une fébrilité adolescente, Hervé Gagnon fanfaronne, évoquant, pour briser la glace, ses chiffres de ventes et les revenus qu’il en tire. Manifestement, il ne sait pas encore à quel auditoire il a affaire. Pendant près de deux heures, elles l’interrogent sur ses techniques narratives, ses méthodes de recherche et ses sources d’inspiration. « Je suis sorti de là complètement sur le cul, me dira-t-il plus tard. Elles avaient dépouillé mes livres avec une minutie que je n’ai pas vue souvent. J’ai été soufflé par la pertinence des questions. Ça a fini par être une expérience profondément humaine. »
Ses écrits trouvent un écho puissant entre ces murs. Certaines femmes, comme Emma*, n’avaient jamais terminé un livre de leur vie avant de tomber sur L’héritage des Cathares, premier tome de la série Damné. « Les 400 pages, je les ai dévorées en quatre jours », lui dit-elle avec un sourire lumineux, émerveillée par le miracle qu’elle découvre. « J’arrêtais plus. J’en oubliais de manger, d’aller dormir ! » Les titres de la tétralogie sont si populaires qu’il faut s’inscrire sur une liste d’attente pour les emprunter à la bibliothèque.
Né avec un signe de malédiction sur le visage, élevé sans amour, le guerrier Gondemar de Rossal a fini par devenir le monstre que tous avaient cru voir en lui. Partout, il sème la terreur et le sang, une effroyable descente aux enfers dont il aura, au prix de cruels sacrifices, la chance de se racheter. Damné, c’est une fable sur la prédestination, le libre arbitre et la rédemption, déguisée en récit d’aventures médiévales. Une série qui demande si on peut jamais échapper à un destin qui semble tracé d’avance ; si le bien et le mal sommeillent en chacun de nous ; si on peut choisir qui on sera ; si on peut survivre à ce qu’on a été.
« Je peux vous faire un commentaire ? » demande Guylaine*, une femme aux grands yeux ahuris dont la lourde peine trahit un sombre passé, en tendant son exemplaire à l’auteur, pendant la séance de dédicaces. « Au début, j’haïssais votre livre. Pis après, ça m’a fait pleurer, j’en ai eu des frissons. Ce que j’ai compris, c’est que malgré toutes les erreurs qu’il a faites, il avait le droit de se pardonner, pis de s’aimer lui-même. »
* Les noms suivis d’un astérisque ont été modifiés, à la demande des femmes, pour préserver leur anonymat.
Cet article a été publié dans le numéro de juillet 2017 de L’actualité.