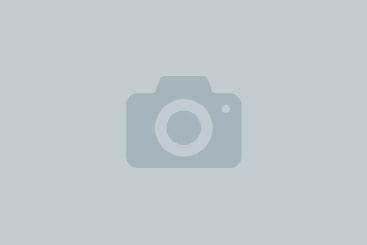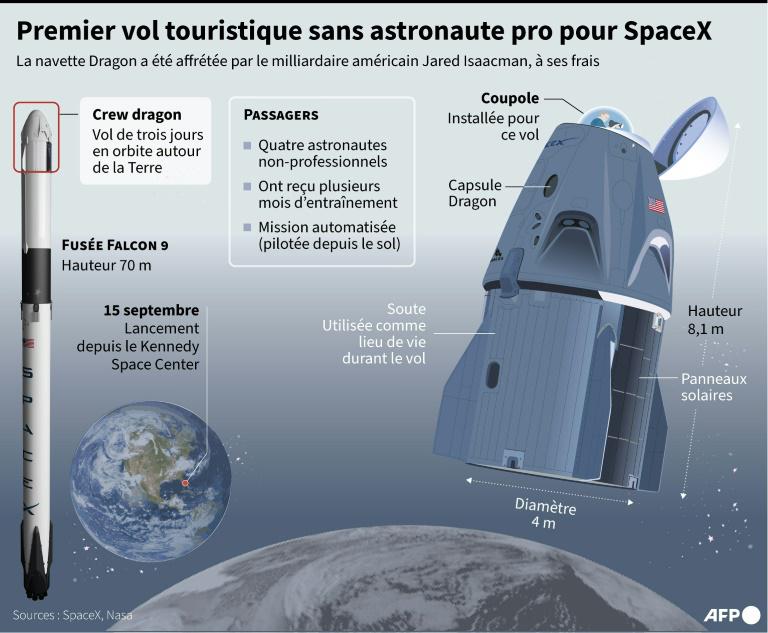Naître sans toit : Youssouph, l’enfant d’un long voyage
« – Vous êtes Bintou ? demanda le livreur, un sac en papier à la main rempli d’un poulet braisé alloco préparé à l’ivoirienne, et du riz.
– Oui, c’est moi, affirma un homme d’une cinquantaine d’années qui se trouvait là, à l’entrée de l’hôtel social de Vigneux-sur-Seine.
– Tenez, de la part de Mme Samra Seddik. »
Voilà comment le poulet a été volé ce soir-là. C’était le 21 juillet, entre les deux confinements. Certes, le livreur ne pouvait pas deviner que Bintou était un prénom de femme. Il ne pouvait pas non plus imaginer que le voisin de Bintou était un homme prêt à voler pour manger.
Sur le moment, Bintou n’était pas contente qu’on lui vole son poulet. « Il semble qu’il avait très faim, lui ! », lance-t-elle. Cinq mois plus tard, l’histoire la fait sourire. « La pauvre Mme Samira, elle a dû me faire livrer un nouveau poulet ! Elle m’a dit au téléphone : “Bintou, ne loupez pas le livreur cette fois-ci, sinon il va encore livrer à quelqu’un d’autre.” Quand le même livreur est revenu, il était effrayé : “Vous êtes vraiment Bintou ? Vous êtes bien sûre ?” J’ai dit : “Oui, c’est moi, c’est Bintou.” »
Quelques jours plus tôt, Samra Seddik, sage-femme depuis douze ans en banlieue parisienne, avait reçu un SMS d’une conseillère de l’assurance-maladie, basée à Évry : « Pouvez-vous visiter Bintou F. à Vigneux-sur-Seine ? Elle sort de la maternité dans quelques jours. »
De son côté, Bintou, qui venait de mettre au monde Youssouph, a reçu un message : « Vous serez hébergée du 24 au 27 juillet à l’hôtel social de Vigneux-sur-Seine. » En l’espace d’une semaine, à peine sortie de la maternité, Bintou a changé trois fois d’adresse.
Depuis le 4 août, elle n’a plus bougé, mais elle sait que la stabilité est fragile et qu’il lui faudra trouver un travail et un appartement pour être à l’abri. On dit que changer régulièrement ces femmes d’endroit, c’est une façon de leur rappeler qu’elles sont toujours « dans le dispositif du 115 », le Samu social de Paris.
Elles peuvent recevoir un SMS : « Dans une heure, vous devez être à tel endroit. » Elles doivent alors récupérer leurs bagages, leur enfant et passer d’une ville à l’autre sans être véhiculées, dans des zones commerciales souvent complètement isolées.
→ ENQUÊTE. Plusieurs centaines de migrants de Saint-Denis toujours à la rue
Une fois dans le huis clos de sa chambre, Bintou a avoué à « Mme Samira », comme elle l’appelle, n’avoir pas mangé depuis la veille. Son dernier repas avait été un morceau de pain et de l’eau. Samra lui a dit : « Bintou, je suis moi-même maman, et je sais qu’une femme qui allaite a très faim. Si vous ne vous alimentez pas bien, votre lait n’est pas riche. »
Le soir venu, Samra a commandé à l’adresse de Bintou le fameux poulet à l’ivoirienne… Faisant non pas un, mais deux heureux ! « Quelqu’un qui t’offre un repas quand tu as faim, tu ne peux pas l’oublier », se souvient Bintou.
Droit d’asile
Bintou a 21 ans. En arrivant en France, elle a obtenu de l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) le statut de protection internationale comme réfugiée pour les dix années à venir, car elle court un danger pour sa vie si elle revient au Sénégal. Avec un enfant ou sans, elle aurait obtenu le droit d’asile, quoi qu’il arrive.
Dans son hôtel social, entre Mondial Tissus, Décathlon et Buffalo Grill, elle regarde son fils qui ne veut pas dormir. Youssouph a 5 mois. Il est l’enfant de la fin d’un long voyage. L’enfant d’un viol, en pleine rue, lorsqu’elle est arrivée à Paris. L’enfant d’une blessure, de l’irréparable. Mais surtout, « tu es l’enfant de Dieu », lui murmure-t-elle en diakhanké à l’oreille dans la nuit. « Ite mou alla la deenaano lè ti. »
Elle le soulève doucement au-dessus de sa tête, les deux bras nus tendus. Ils se regardent, silencieux, Youssouph ronronne, son nez est pris. Youssouph, ça veut dire Joseph, c’est le nom du prophète. Tous les deux s’observent, les yeux écarquillés dans le noir. Éclairés de loin par la télé allumée sans le son. Le rire de la jeune femme perce le froid au petit matin. C’est début décembre. Youssouph essaie d’attraper son jouet avec la bouche en râlant. Sa petite langue rose fait des va-et-vient sur ses lèvres couleur ébène.
« Idé ! » (« Calme-toi ! »), « Mou kéta ? » (« Qu’est-ce que tu as ? ») lui demande-t-elle. « Hmm tu as faim… », se répond-elle à elle-même. Elle l’attrape sous l’aisselle d’une seule main pour le soulever du matelas et le déposer sur son ventre. Elle empoigne délicatement son petit crâne et le cale sous son sein.
Il saisit aussitôt le téton qui se présente à lui. L’allaitement fait mal à Bintou depuis quelques jours. Elle pince sa lèvre du bas, fronce les sourcils. Son souffle est profond, elle se concentre, croise ses jambes et berce son fils pour oublier sa douleur.
Quand il a fini, elle s’étend, le sein moins gonflé. « Maman souffre, mais lui, Youssouph, il est heureux », lance-t-elle. Il a le regard noir, des sourcils en forme d’hirondelle. Des cheveux en abondance sur le dessus du crâne, presque rien au niveau des tempes. Elle l’étend au milieu du lit sur la couette blanche sans housse, lui masse le crâne un instant, remuant lentement ses doigts sur lesquels flotte une bague en pierre turquoise.
Elle se redresse, soulève le rideau de la fenêtre. Le parking est vide. Le temps passe lentement dans cette chambre. Il est six heures du matin. Dehors, les bus font les rondes pour les étudiants dans la brume de l’hiver. Il est loin, le Sénégal. Le goudron a remplacé la terre battue. « Si je ferme les yeux, je vois un grand fleuve, si je les ouvre je vois des parkings », elle se rassoit.
La fenêtre de son précédent hôtel donnait sur un magasin de pneus. Là-bas, Bintou n’a pas osé se laver une seule fois car les douches étaient mixtes. Quatre jours après son accouchement, elle se retenait pendant des nuits entières pour ne pas avoir à aller aux toilettes en bas de l’immeuble, car il n’y avait pas de cuvette pour les femmes.
→ LES FAITS. CEDH : la France condamnée pour les conditions de vie des demandeurs d’asile
Dans sa nouvelle chambre, Bintou a une salle de bains et des toilettes. L’hôtel où elle se trouve a longtemps accueilli exclusivement des hommes, il dépendait alors d’une ONG. Depuis un peu plus d’un an, il est rattaché au service d’hébergement d’urgence du 115, il est devenu mixte et accueille surtout des femmes seules avec enfants ; 134 adultes vivent ici.
À l’entrée, une feuille A4 tient à quelques bouts de ruban adhésif : « VISITES INTERDITES ». Puis une autre feuille, plus petite : « Masque obligatoire ». Aux fenêtres, le linge s’aère. Sur le bord d’une autre, un pack de Badoit tient en équilibre.
Lorsque Bintou reste trop longtemps dans cette chambre, elle pense au passé. Elle sort de là dès qu’elle peut, mais jamais de nuit. « Quand tu es pauvre, tu ne sais jamais ce que tu feras demain, tu passes ton temps à penser, tu fais rien d’autre que t’inquiéter. » Youssouph lui empoigne le menton comme pour la faire taire.
« Ce petit-là, il me fatigue », elle martèle chaque syllabe en souriant et le redresse au creux de sa nuque. Le fils enlacé au cou de sa mère, ils ne bougent plus, c’est une gravure à contre-jour. « Je vais réaliser mes rêves d’abord, puis je lui trouverai un papa. »
→ PODCAST. « Ma rencontre avec Bintou, mère en exil »
Elle dort habillée, comme chaque nuit. Le bouton de son jean défait, elle retire ses grosses chaussettes en laine. Dégrafe son soutien-gorge noir, son sein est en train de cicatriser. Sur le lit, la télécommande repose sur ses larges créoles en argent. Ses yeux en amande sont fatigués, cernés, mais ses pommettes relevées lui donnent l’air en forme.
Une fois nue, elle déshabille son fils. Elle entre dans la douche en le tenant dans les bras. Elle a toujours peur qu’il glisse contre sa peau mouillée, alors elle laisse un tissu pour mieux accrocher et lui passe un gant orange le long du corps. Elle enroule ensuite l’enfant dans une serviette et le dépose dans son berceau. Une odeur vanillée s’est emparée de toute la salle d’eau.
C’est jour de la grande ablution, le « ghousl » selon la tradition musulmane : Bintou est au lendemain du dernier jour de ses règles. Pendant les menstruations, une musulmane ne fait pas les cinq prières quotidiennes. Elle est toujours libre d’invoquer Dieu, mais c’est une période de repos, elle ne se lève plus le matin pour prier, ni pour jeûner. « Sans être déconnectée de Dieu pour autant », précise Bintou.
Protégée par sa foi
Après s’être lavée, elle commence le rituel de l’ablution. L’eau tiède coule et, étape après étape, la jeune femme frotte avec un gant la partie droite de son corps. Youssouph, de l’autre côté de la vitre embuée, regarde le plafond sans rien dire. Bintou répète les mêmes gestes sur tout le côté gauche de son corps. Pour se purifier membre après membre. Elle termine par ses pieds. Le droit, puis le gauche.

« Quand je prends ma douche, je réfléchis aux choses passées. Ça me fait du bien. Mon esprit respire, c’est comme si je le lavais. Il m’arrive de pleurer. Je pleure mes sœurs, mon père, et mon mari. Avec le bruit de l’eau, personne ne peut savoir que tu es en train de pleurer. Les larmes sortent et se mélangent aussitôt à l’eau qui te lave. »
Une petite échelle en bois mène à un grenier sous le plafond de la chambre. Une sorte de cabane avec un lit d’appoint. Là-haut repose sa robe de prière jaune et noir. Bintou monte prudemment, enfile sa djellaba et redescend en serrant les dents. « Avant d’être enceinte, je grimpais aux arbres et je courais vite. Maintenant que j’ai Youssouph, j’ai le vertige, je m’essouffle, et j’ai toujours peur de mourir. »
→ REPORTAGE. À Mytilène, sur l’île de Lesbos, la foi vibrante des migrants
Elle a déposé l’enfant sur le lit. En deux mouvements, elle noue son foulard violet à pois blancs sur ses nattes tressées à même le crâne. Bintou est prête. Elle déroule sur le sol son tapis rose venu du Sénégal, s’incline et chuchote en arabe : « Bismillah ar rahman ar rahim/Al hamdou lillahi rabbi al alamine… » (« Louange à Allah, Seigneur de l’univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux »). La respiration de son fils accompagne ses lents mouvements.
« Mme Samira » dit que c’est parce que Bintou a la foi que Dieu la protège. « Que ce soit la religion chrétienne ou musulmane, ça aide ces femmes à tenir. » Samra dit souvent qu’à chaque naissance, le sort du monde se rejoue. Avant de s’installer en libéral, Samra a fait une mission humanitaire en Jordanie, à la frontière syrienne, en 2013, où les femmes accouchaient sous des toiles de tente.
Elles disaient à leur ennemi de guerre : « Tant que nous donnons la vie, la victoire est à nous, Bachar (Bachar Al Assad, NDLR). » « La femme enceinte est déjà dotée d’une puissance incroyable. Mais les femmes en exil le sont encore plus. Elles peuvent soulever des montagnes. »
Le métier de sage-femme l’a rendue témoin : « C’est incroyable ce qu’une femme peut fabriquer en neuf mois. Tous les mécanismes du corps. Le développement du fœtus. La naissance ne peut pas être le fruit du hasard, c’est impossible. Ça ne fait que renforcer ma foi. »
En plus de son métier, Samra a fondé en 2016 l’association Un petit bagage d’amour, pour venir en aide aux femmes enceintes réfugiées ou dans la précarité. Lorsqu’elle pèse le petit corps des bébés dont elle s’occupe, elle se dit souvent que l’enfant qu’elle tient dans les bras sera peut-être un grand musicien, un sportif, un astronaute… Et ce sera sa revanche sur la vie.
Le 11 février 2019, Bintou a perdu celui qu’on appelait Ibou Diop. Le couturier réputé de Tambacounda était son mari. Cinq mois après leur mariage, dans le quartier appelé « Dépôt », où ils vivaient, en plein cœur des élections présidentielles, une confrontation a eu lieu entre militants.
« Le jeune tailleur sorti pour s’enquérir de la situation a été poignardé par un groupe de jeunes encagoulés », titraient les journaux le lendemain. On n’en saura jamais vraiment plus sur les circonstances de sa mort.
Fuir le Sénégal
Bintou rentrait de l’école où elle apprenait à coudre, lorsqu’elle a croisé deux hommes en train de parler d’un « Ibou » qui venait de se faire assassiner en pleine rue. Son cœur s’est mis à battre, avant le dernier virage, elle a croisé un enfant qui pleurait sans rien dire. À la fin des trente minutes de marche, le cœur chargé d’une mauvaise intuition, elle apprenait que son mari de 30 ans était mort. On lui a caché le corps, comme le veut la tradition.
« Moi je voulais savoir dans quels vêtements il avait été poignardé, mais je n’ai vu son corps que le lendemain à la mosquée. » Pour Bintou, une des grandes leçons de son existence, c’est la vitesse à laquelle les couleurs peuvent changer dans une vie. Du ciel bleu sous le soleil humide de Tamba un jour de noces au sang meurtrier, mélangé à la terre sableuse, devant l’atelier de couture d’un homme « bon et généreux » réduit au néant.
Ce morceau de terre, ce jour-là, semblait monter au ciel, Bintou était inconsolable. « J’ai refusé de retirer ma plainte, je voulais que justice soit faite. » Chaque jour, les responsables du crime lui proposaient de l’argent. Résistant aux menaces, elle se savait désormais en danger de mort. Après les quatre mois et dix jours de deuil qu’impose la religion musulmane, enfermée dans la chambre de son défunt mari, elle a décidé de fuir pour toujours.
→ REPORTAGE. Les pères de migrants sénégalais condamnés à une peine inédite
Elle a retiré le pagne bleu et rouge du deuil cousu par un ami couturier, et elle a enfilé un tee-shirt de toutes les couleurs, manches courtes, un gilet, et un jean moulant. Ses cheveux tressés par dizaines de fines nattes détachées. Elle a quitté son pays un soir de juin. Juste le temps de dire adieu à son père malade, alité, qui lui disait de partir loin d’ici : « Lay fana ! » (« Sois courageuse ! »). Il a ajouté : « Ikana nyena ibodoulaakou » (« Et n’oublie pas d’où tu viens »).
Bintou est la dernière enfant d’une fratrie de six. « Souvent, les derniers de fratrie sont plus libres et réalisent leurs rêves. Les aînés ouvrent une route, les derniers sautent et dansent dessus. » Dans un sac à dos rouge, elle a glissé une photo de Finda, sa mère, qu’elle n’a presque pas connue. Elle a ajouté quelques jupes et robes cousues par Ibou ainsi qu’un collier doré offert par sa sœur le jour de son mariage.
L’odyssée de Bintou
À 20 ans, elle réalisait le périlleux voyage du Sénégal à la France pour ne pas être tuée à son tour. N’emportant rien d’autre que le gros sac à dos rouge qu’elle prenait pour ses cours de couture à Tamba. Partie en bus pour Dakar, envolée pour Casablanca, puis Tanger, d’où elle pensait embarquer sur un bateau de fortune pour l’Espagne. Le passeur lui a volé l’argent, elle n’est jamais partie. Il lui a sûrement sauvé la vie sans le savoir.
Elle a alors mis le cap pour l’Algérie, sur les conseils d’une jeune femme inconnue. Là-bas, sur le marché aux poissons d’un port dont elle a oublié le nom – elle a oublié des morceaux entiers de son passé –, elle a sympathisé avec un pêcheur marseillais qui a accepté de la prendre avec lui sur son bateau. Un grand bateau blanc.
→ GRAND FORMAT.« J’ai été esclave en Libye »
« J’étais tétanisée, le voyage a duré moins de deux jours, mais je n’ai pas fermé l’œil. Je craignais de me retrouver seule avec un homme au milieu de la mer. » Ils n’ont pas parlé. Il l’a laissée en paix. « Il a eu pitié de moi, je crois. » Arrivée à Marseille, il l’a confiée à un ami qui prenait un train pour la capitale.
« Mon voyage n’a été que ça. À chaque fois, un parfait inconnu m’aidait, me tendait la main, me mettait sur le chemin et me disait “on est arrivé” une fois à destination, et puis je ne le revoyais plus jamais. Tu ne te retournes pas, tu regardes devant. Le présent. » Bintou est arrivée en région parisienne le 1er septembre 2019.
Elle n’a aucune idée du nom de la ville. Elle se souvient juste être sortie d’une gare et avoir dormi pendant des jours sous des cartons. M. Kabay, lui, a un souvenir très précis de la première fois qu’il a aperçu Bintou. Il est chauffeur de VTC. Il passait devant la gare de Saint-Michel-sur-Orge pour récupérer des clients à l’heure de pointe. Il faisait encore jour, trois hommes rôdaient autour d’elle.
« J’avais la fenêtre ouverte, j’ai croisé son regard en larmes, quand elle a vu que je la regardais, elle m’a demandé de l’aide. Je me suis approché, en me voyant les trois hommes sont partis. » En ce sombre mois de septembre, Bintou s’est retrouvée enceinte, elle ne le savait pas encore.
M. Kabay est sorti de sa voiture, il lui a demandé d’où elle venait. Comme Tamba était la ville natale de sa femme, il l’a fait monter dans sa voiture et a appelé Awa : « J’ai une sœur de ton village dans la voiture, elle a été abusée par un groupe d’hommes à Saint-Michel. » « Amène-la ici », lui a répondu sa femme.
M. Kabay a immédiatement demandé à Bintou d’appeler son père, à Tambacounda. Il voulait lui parler. L’homme malade lui a confié : « On m’a confisqué ma fille. Garde-la comme ta fille. » Le père de Bintou s’est éteint quelques jours plus tard.
M. Kabay a tenu sa promesse. Avec sa femme Awa et leurs cinq enfants, ils ont accueilli Bintou comme leur propre fille pendant neuf mois. M. Kabay voit l’existence comme une grande chaîne de solidarité. On lui a tendu la main quand il avait 29 ans, alors même qu’il fuyait la guerre civile au Sierra Leone, il y a vingt ans. Il pensait que la France ne serait qu’une étape vers l’Amérique. Il a finalement adopté ce pays.
Que dira-t-elle à son enfant lorsqu’il lui demandera qui est son père ? « Il est l’enfant d’un viol mais il est l’enfant de Dieu. C’est ce que je lui dirai. Je dirai à mon enfant la vérité. Tôt ou tard, s’il me le demande, je lui dirai toute mon histoire. C’est mon fils. Je ne veux pas lui cacher d’où il vient. Dans notre religion, Maryam, fille d’Imra et Hannah, a donné la vie à un enfant sans père, un enfant de Dieu. La vérité, même quand elle est difficile à comprendre, est la meilleure façon de se construire. »
Bintou prie le nom de Marie, Maryam, celui de Jésus lui est moins familier, elle ne sait pas que c’est cette naissance que célèbrent les chrétiens au moment de Noël. Elle considère la mémoire comme le lieu de la transmission de notre identité. Ce qu’on choisit de raconter, c’est ce qui a du sens pour l’éternité. C’est la ténacité et l’endurance de la mémoire qui célèbrent ensemble l’existence.
Avant de partir pour la maternité, après avoir dormi pendant neuf mois sur leur canapé, Bintou savait que M. Kabay et Awa ne pourraient pas la garder dans leur salon avec un nouveau-né. Elle a fait les démarches pour être prise en charge dans un hébergement d’urgence.
En sortant de la maternité, elle a découvert la solitude d’une chambre d’hôtel. Elle a découvert l’attente des rendez-vous administratifs, des cours de français, des rencontres avec « Mme Samira », de la collecte, chaque jeudi, de denrées alimentaires à l’épicerie solidaire L’Escale de « Sainte-Gen’», comme ils disent.
Choisir la vie
Le verdict du procès de son mari a été rendu le 2 juillet dernier par la première chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda, chargé de l’affaire. On a vu défiler à la barre treize accusés. Alors que Bintou mettait au monde son enfant dans un hôpital de la banlieue parisienne, le meurtrier d’Ibou Diop était emprisonné pour les quinze prochaines années. Elle ne connaît pas ce verdict. Elle ne veut plus rien savoir de ce passé.
Bintou « choisit la vie au sens plein, fort et divers », selon les termes du juriste et politologue Raphaël Draï. Elle s’est ainsi choisi « une vie » dans la « grande vie » que l’on ne choisit pas. Elle a pris en main son destin et lui a donné un sens. Au croisement de ce qu’elle choisit de raconter et de ce qu’elle choisit de taire.
Une brique de lait repose sur le rebord de sa fenêtre qui lui sert de réfrigérateur en hiver. Elle écrit un SMS à Awa. Elles ont rendez-vous ce soir chez les Kabay pour cuisiner une pâte de fataya, sorte de beignets sénégalais à la viande hachée. Ces gens lui ont sauvé la vie. Elle lui écrit en diakhanké phonétique. Les bancs de l’école coranique, elle n’y a pas passé beaucoup de temps. Elle a appris l’alphabet sur un mur jaune, quelques mots de français et d’arabe.
→ TRIBUNE. De la « crise des migrants » à la crise de l’accueil
À 11 ans, elle quittait l’école et était mariée de force à un homme de 45 ans. La famille de Bintou était pauvre, sa mère n’était plus là, son père croyait bien faire. Enceinte de cet homme à 16 ans, elle a pris la fuite. À la naissance de l’enfant, sa grande sœur l’a aidée à divorcer et a élevé le petit Mohammed comme son fils, au milieu de ses propres enfants.
Bintou était trop jeune pour être mère. « L’enfant que j’ai eu il y a quatre ans appelle ma sœur “maman” et me considère comme sa tante. Même si je l’ai mis au monde, je n’ai pas pu, en quittant le pays, l’arracher à ceux qu’il considère comme sa plus proche famille. »
À l’épicerie sociale et solidaire de L’Escale, à quelques stations de bus de l’hôtel où elle vit, une dizaine de bénévoles et travailleurs sociaux salariés par la commune s’agitent, remplissent des cartons, accueillent. Ils s’appellent Martine, Jessie, Saïd… En trois heures d’ouverture chaque après-midi, ils voient défiler une soixantaine de personnes dont ils connaissent bien le visage.
Les bénéficiaires sont convoqués sur un créneau horaire strict. Depuis le début de la crise sanitaire, ils ne peuvent plus entrer dans le magasin. Ils restent alors à l’entrée, au pied du HLM où se trouve le local. Ils font leur choix de l’autre côté d’un plexiglas où se retrouvent par dizaines des femmes seules avec leur enfant en file indienne. Bintou se fond dans la masse avec sa poussette. Elle devient l’une d’entre elles.
Maternités
« Que vont devenir toutes ces femmes ? » Dominique, 70 ans, est la présidente de l’association. « J’ai été nommée à la présidence la pire année, j’ai le même problème que Macron. » Elle sort fumer sa cigarette, une doudoune sans manches au-dessus d’un gros pull. Le magasin va bientôt fermer, le rythme s’est calmé.
Elle est bénévole ici depuis neuf ans. « Normalement, on est une béquille, on s’appelle L’Escale, on devrait soulager les familles un mois ou deux. En réalité certains reviennent chaque semaine depuis un an. » Chaque bénéficiaire, en fonction de la nature de son foyer, a droit à un budget maximum établi par l’assistante sociale.
Au moment de remplir le dos de la poussette, Bintou troque une conserve de petits pois contre les deux briques de lait qu’elle avait prises. Dominique la regarde : « Ils sont tous là avec leur misère, leurs dettes, leurs erreurs. Mais ce qui m’inquiète, c’est qu’on n’a jamais vu autant de femmes seules avec un enfant. »
→ ENQUÊTE. Familles à la rue dans Paris, le point de rupture
Les rayons de soleil jouent avec les roues de la poussette et les panneaux des enseignes. Ces derniers jours, les couchers du soleil sont flamboyants. Dans le quotidien en France qui est le sien désormais, Bintou accomplit cette fois sa maternité.
« C’est le jour où ta maman n’est plus là que tu connais sa valeur, confie-t-elle, en revenant de l’arrêt de bus avec Youssouph, la poussette chargée. Le jour où tu accouches, tu commences seulement à comprendre ce qu’elle a souffert. On a tous une maman. »
Bintou sèche ses larmes. « Tu fatigues enceinte. Ensuite ton enfant pleure, puis pleure, puis pleure. Si ton fils dort, tu dors. S’il se réveille, tu te réveilles. Le matin tu le laves avant de te laver. Un jour, ton enfant devient grand, et après tout ce que tu lui as donné, il te dit “non” en te regardant dans les yeux », elle baille et éclate de rire en même temps.
L’autre nuit, elle a rêvé de sa maman. Dans son rêve, elle venait juste de naître. Sa mère assise en tailleur l’avait posée sur la cheville. « Ma maman me caressait les cheveux et me chantait des chansons pour que je m’endorme. » Tout en sortant son fils de la poussette, elle brise tout malentendu : « Ce n’est pas une histoire vraie, hein ! C’était un rêve. Je ne me souviens pas de ma maman. »
Elle remonte dans sa chambre. Retire ses boucles d’oreille créoles qu’elle lance sur la couette. « Quand tu es mère seule avec un enfant, ton fils n’a que toi, ton épaule, ton doigt et ton sein. Pour moi, Youssouph est mon premier fils. C’est lui qui est collé à moi tout le temps. Personne ne me seconde. Personne ne veut s’occuper de lui à ma place. Je suis sa mère. »
ENTRETIENAvec Christine Laconde, directrice générale du Samu social de Paris
La Croix l’Hebdo : Comment expliquez-vous le nombre croissant de femmes migrantes en France ?
Christine Laconde : Les flux migratoires des personnes isolées se sont largement féminisés ces dix dernières années. Des années 1960 aux années 1990, on parlait d’une migration quasi exclusivement masculine. En 1993, au moment de la création du Samu social de Paris, il n’y avait presque pas de femmes.
Aujourd’hui, les chiffres montrent qu’on fuit de plus en plus son pays parce qu’on est une femme. La fuite est due à une aspiration à la liberté pour la femme et ses futurs enfants. Ces personnes qui quittent leur pays fuient de manière irrépressible. Par peur que leur fille soit excisée, par peur de subir un mariage forcé. Elles fuient sans connaître la suite.
Le phénomène semble avoir été mal apprécié dans ses conséquences.
C. L. : Mal apprécié et donc mal accompagné. Les femmes exilées se sont débrouillées et continuent de se débrouiller comme elles peuvent. Avant d’appeler le 115, pendant des années, elles essaient de se débrouiller. On observe un soutien communautaire plus ou moins aimable, l’hébergement chez des tiers peut être à l’image aussi bien d’une très belle solidarité communautaire que d’un esclavagisme moderne incroyable.
Ces femmes tombent enceintes, de manière voulue ou non. Et souvent, l’arrivée de l’enfant chamboule tout. Elles sortent de la maternité, et n’ont plus de toit. Et on le sait, une femme sans toit est une proie.
C’est ainsi que naissent des familles à la rue ?
C. L. : Il y a quinze ans, des familles, et surtout des femmes à la rue ou en errance, se sont mises à appeler le 115. Le public a évolué de façon fulgurante, les acteurs ont paré au plus pressé. Tout ce qui était en place était prévu pour des hommes isolés. Nous sommes alors entrés dans le piège de l’hôtel.
Je parle d’un piège, je devrais parler de drogue dure. Non seulement les places en hôtel sont devenues une ressource majeure, dont on ne peut plus se passer, mais en plus ces places ne sont pas adaptées, et les personnes en grande précarité s’y sédentarisent.
Au début, il s’agissait de quelques centaines de cas, puis c’est passé à quelques milliers, ça se compte aujourd’hui en dizaines de milliers. La concentration en région parisienne est logique. C’est la capitale, la ville d’arrivée. Mais les hôtels trouvés sont de plus en plus loin de Paris, aux lisières des villes, dans des lieux où on va la journée en voiture pour faire ses courses, mais qui ne sont pas adéquats pour vivre.
Et les situations stagnent. Les publics se retrouvent à attendre des droits de séjour de plus en plus longtemps. Il faut six à sept ans pour obtenir un titre de séjour aujourd’hui, et avoir un enfant sur le sol français n’aide plus du tout comme autrefois.
Que peut-on faire, à notre niveau ?
C. L. : Notre capacité d’indignation est déjà un bon moteur. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables et il faut continuer à garder les yeux ouverts, à s’indigner. Pendant le premier confinement, pour la première fois de façon aussi aiguë, nous avons été exposés à des personnes qui avaient faim. Qui avaient passé trois, parfois quatre jours sans manger. Ni elles, ni leurs enfants. Ce n’est pas acceptable.
Ce n’est pas non plus normal de vivre chez des tiers qui vous demandent des services sexuels. Il est faux de penser que c’est le prix à payer pour une forme de modernité. Dans un pays comme la France, qui a ses difficultés mais qui n’est pas un pays pauvre, on ne peut pas accepter que des gens soient dans des tentes avec des rats qui leur bouffent les pieds. Le débat sur la question migratoire est trop souvent stérilisé par des idéologies extrêmes.
J’exagère à peine : d’un côté, ceux qui ont l’impression d’une vague de submersion, avec un effet d’appel d’air – aider un migrant c’est en laisser trois autres arriver – traitant le camp d’en face d’irresponsables, d’irréalistes. De l’autre, un camp qui accuse le premier d’être facho. J’observe qu’on ne veut pas poser les termes de manière pragmatique et mature, on refuse le consensus. Ce qui se joue avec la question migratoire, c’est le miroir des maux de la société.
Nous sommes confrontés à une très grande hypocrisie du système qui mène à l’hyper assistance de populations entières. Notre défi est d’être capables de pragmatisme. Il ne faut pas négocier avec la qualité des réponses qu’on apporte, l’enjeu n’est pas juste de porter assistance, l’enjeu est de redonner à ces individus le pouvoir de choisir et d’agir sur leur vie.