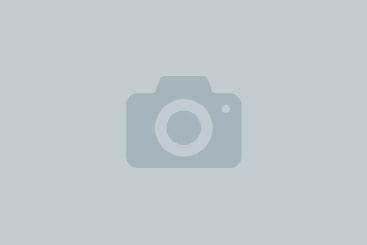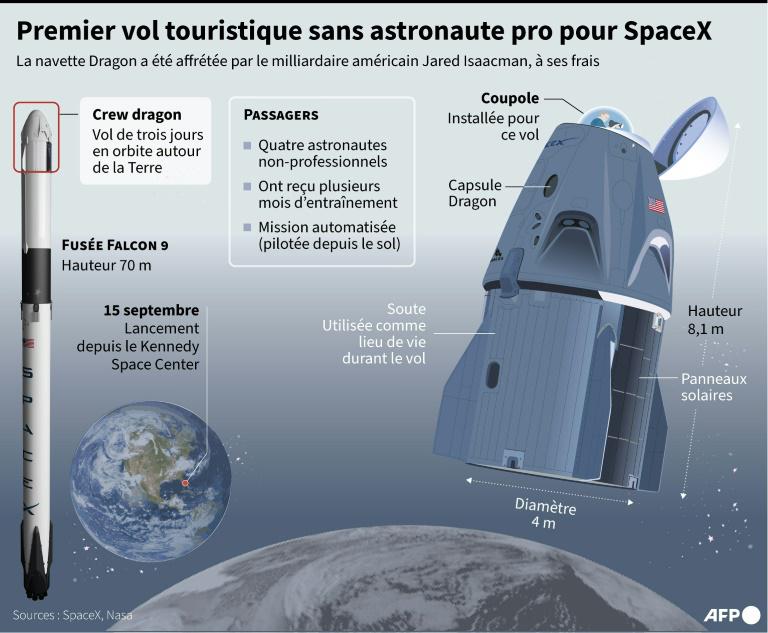Aux origines du salaire minimum
Par Michel Husson
«Le coup de pouce au Smic, on sait que ça détruit des emplois, donc ça n’est pas la bonne méthode [1].» Cet argument sobrement résumé par Muriel Pénicaud, la ministre française du travail, a une longue histoire que cet article cherche à restituer. Il montre que la tension entre les doctes exposants des lois incontournables de l’économie et les partisans de la justice sociale a toujours existé, et qu’elle subsiste aujourd’hui.
Les lois sinistres de l’économie
«Le cadavre dans le placard de l’Angleterre, c’est que son peuple est sous-alimenté» écrit en 1865 un médecin, Joseph Brown [2]. Il y a «quelque chose de pourri» derrière la puissance économique du pays (p. 2). Mais une augmentation des salaires n’est pas pour autant le remède approprié, car «les lois de l’économie politique sont inexorables ! Violez-les, et le châtiment finira par s’abattre sur vous» (p. 7).
Ce dilemme résume parfaitement le point de vue des économistes dominants de l’époque: certes, il existe des situations sociales insupportables mais les lois de l’économie empêchent que l’on puisse y remédier. Telle est déjà la démarche de John Stuart Mill, l’un des économistes les plus influents à l’époque, dans ses Principes d’économie politique [3] publiés en 1848. Mill y examine les «remèdes populaires contre l’abaissement des salaires.» Le moyen le plus simple «pour maintenir les salaires à un taux convenable est une fixation légale [et] quelques-uns ont proposé d’établir un minimum de salaire.» L’idée d’un salaire minimum était donc déjà dans l’air du temps, et on trouve même l’esquisse de ce que le Trade Boards Act de 1909 mettra en œuvre: le niveau du salaire minimum pourrait être fixé paritairement par des «conseils appelés en Angleterre Bureaux de commerce [Trade boards], Conseils de prud’hommes en France [où l’on pourrait] discuter à l’amiable le taux des salaires et les promulguer de manière à les rendre obligatoires pour les patrons et pour les ouvriers. Dans ce système on ne se déterminerait point d’après l’état du marché, mais d’après l’équité naturelle, de manière à donner aux ouvriers un salaire raisonnable et au capitaliste un profit raisonnable» (p. 403).
La piste du compromis était déjà esquissée, mais elle soulevait un problème de doctrine: du point de vue d’une économie politique rigoureuse, que signifient un salaire et un profit «raisonnables»? Mais il y a plus. Mill examine aussi l’idée d’une garantie de l’emploi appuyée sur une taxe sur les riches: «le sentiment populaire estime que c’est un devoir du riche ou de l’État de trouver de l’emploi pour tous les pauvres. Si l’influence morale de l’opinion ne détermine pas les riches à épargner sur leur consommation ce qu’il faut pour donner aux pauvres du travail et un salaire raisonnable, on suppose que le devoir de l’État est d’y pourvoir par des taxes locales ou générales» (p. 405). Ici encore, on constate que l’idée d’une «garantie de l’emploi» (job guarantee) défendue aujourd’hui par des économistes hétérodoxes était déjà dans le débat public.
Mill récuse ces propositions à partir de l’argument qui sera constamment utilisé dans les débats sur le salaire minimum: «si la loi ou l’opinion parvenait à tenir les salaires au-dessus du taux qui résulterait de la concurrence, il est évident que quelques ouvriers resteraient sans emploi.» Ce paragraphe contient déjà l’opposition fondamentale entre «l’opinion» et les lois de la concurrence, autrement dit entre l’idéal et la science, en l’occurrence l’économie politique. La tâche de l’économiste est donc décidément «lugubre»: même s’il partage les aspirations les plus généreuses, il se doit d’expliquer pourquoi elles sont irréalistes et conduiraient à des effets pervers.
La démonstration de Mill s’appuie sur la théorie dite du fond des salaires. Elle avait déjà été formulée très clairement par John Ramsay McCulloch [4] en 1826: à un moment donné, «les salaires dépendent du montant du fonds ou du capital qui est consacré au paiement des salaires, comparé au nombre de travailleurs» (pp. 4-5). Mill la reprend telle quelle: «Les salaires dépendent donc du rapport qui existe entre le chiffre de la population laborieuse et les capitaux quelconques affectés à l’achat du travail, ou pour abréger, le capital (…) Le sort de la classe laborieuse ne peut être amélioré que par un changement du rapport à son avantage, et tout plan d’amélioration durable qui n’est pas fondé sur ce principe est une déception» (pp. 390-391).
Le montant total des salaires est donc donné. Si on augmente le salaire individuel, le nombre de personnes employées doit alors baisser arithmétiquement. On dirait aujourd’hui que l’élasticité de l’emploi au salaire est égale à l’unité: une augmentation de salaire de 1 % conduirait à une baisse des effectifs de 1 %. Or, cette théorie n’a pas vraiment été abandonnée: elle est reprise à 70 %, puisqu’un «consensus» s’est pendant longtemps établi autour d’une élasticité de 0,7 [5].
Pourtant, Mill avait lui-même renoncé à cette théorie dans sa recension du livre On Labour [6] de son ami William Thornton: «La doctrine enseignée jusqu’ici par la plupart des économistes (y compris moi-même) qui niait la possibilité que les négociations collectives (trade combinations) puissent augmenter les salaires (…) a perdu son fondement scientifique, et doit être rejetée [7]» (p. 52).
Alfred Marshall va remplacer John Stuart Mill dans le rôle d’économiste de référence. Lui aussi se dit préoccupé par la lutte contre la pauvreté, qui aurait selon lui été la raison de son choix de la profession d’économiste. Mais sa doctrine sur ce point est floue: comme le mentionne Joan Robinson avec sa causticité habituelle, Marshall avait «une façon rusée (foxy) de sauver sa conscience en mentionnant des exceptions, mais en le faisant de telle sorte que ses élèves pouvaient continuer à croire en la règle [8]» (p. 2).
On retrouve chez Marshall la même tension entre les aspirations sociales et les rudes lois de l’économie. Dans une conférence donnée à Cambridge en 1896 [9], où il délivre ses conseils à une nouvelle génération d’économistes, il reconnaît que le mouvement en faveur d’un salaire décent est fondé sur «un grand et important principe» et que l’économiste doit faire sienne l’idée selon lequel «le bien-être du grand nombre est plus important que celui de quelques-uns.» Mais le jeune économiste ne doit pas pour autant «redouter la conclusion à laquelle le conduit l’analyse minutieuse des données» car il n’a pas «d’intérêts de classe ou d’intérêts personnels.» Cette clause est importante (et très actuelle): il est affirmé que les messages de l’économiste reposent sur une pure objectivité scientifique, même s’ils peuvent aller à l’encontre des sentiments et des préférences du messager. Il ne doit pas craindre «à l’occasion», et c’est même sa mission, de «s’opposer à la multitude pour son propre bien.»
Marshall constate ainsi que les appels en faveur d’un salaire décent se multiplient chez les dockers, les mineurs, les fileurs de coton et les souffleurs de verre. Malheureusement, ces «gens ordinaires ne voient pas que, s’ils étaient généralisés, les moyens les plus couramment préconisés appauvriraient tout le monde» (p. 128).
L’irruption de la science dure
Il manquait à Marshall une théorie cohérente sur laquelle fonder ses recommandations. La théorie dite marginaliste (ou néo-classique) va la fournir en introduisant un tournant fondamental dans la formalisation du problème: le salaire d’un travailleur est – ou devrait l’être – déterminé par sa productivité «marginale.»
Dans un article où John Bates Clark, l’un des inventeurs de cette théorie, en donne une présentation vulgarisée, ce dernier renvoie à cette «donnée fondamentale» (basic fact): le salaire «est limité par la productivité spécifique du travail», et donc c’est seulement «quand le produit spécifique d’un travailleur est égal à son salaire qu’il peut conserver son emploi (…) Exiger plus que ce que produit son travail équivaut en pratique à demander un ticket de congé [10]» (p. 111).
Clark ne conteste pas qu’une augmentation du salaire minimum serait souhaitable: il serait même «odieux, pour des personnes aisées, de le nier.» Encore une fois, on retrouve la dissociation entre le souhaitable et le possible. La seule question est de savoir si l’économie peut le supporter, et la théorie ne laisse malheureusement aucune place au doute: «nous pouvons être sûrs – sans qu’il soit besoin de tests approfondis – que l’augmentation des salaires réduira le nombre de travailleurs employés.» Clark va même jusqu’à affirmer que satisfaire aux revendications de l’époque aurait sur les entreprises concernées un effet «comparable à celui d’un ouragan ou d’une révolution mexicaine [sic].»
Enfin, Clark constate que le dénuement et la détresse sociale conduisent les citoyens à se tourner vers l’Etat, mais ce dernier n’est pourtant «en rien responsable de leurs problèmes.» Ici, Clark a recours à une petite touche de stigmatisation: les «défauts sociaux» des plus mal lotis sont à ses yeux une «explication plus convaincante» (pp. 110-111). Voilà le complément nécessaire qui conduira à beaucoup de dérives: les aspirations à une vie décente sont non seulement incompatibles avec les lois de l’économie, mais elles émanent de personnes qui sont responsables de leur état. On a là en germe le pendant habituel de ce montage théorique: les chômeurs sont «inemployables» parce que leur productivité individuelle est trop basse pour qu’ils méritent d’être employés. Et cette déficience ne dépend ni des employeurs, ni de l’Etat.
Cette nouvelle doxa sur le salaire minimum est répétée par Arthur Pigou, en conclusion de son livre sur le chômage [11]: «quand des considérations humanitaires conduisent à l’instauration d’un salaire minimum en dessous duquel aucun travailleur ne sera embauché, l’existence d’un grand nombre de personnes qui ne valent pas ce salaire minimum est cause de chômage» (pp. 242-243).

En 1920, dans The Economics of Welfare [12], Pigou maintient cette position: le remède aux bas salaires – qui, certes, «heurtent la conscience publique» – ne se trouve pas dans l’établissement d’un salaire minimum national qui détruirait des emplois, mais dans «l’action directe de l’État visant à assurer à toutes les familles, avec, si nécessaire, des aides de l’État, un niveau minimum adéquat dans chaque département de la vie» (p. 558). Cependant Pigou va en même temps insister sur les limites de cette action de l’Etat. Il commence par constater qu’il existe «chez les philanthropes pragmatiques un accord général sur le fait que les conditions minimales d’existence devraient être garanties, pour éviter les situations d’extrême dénuement ; et qu’il faut mettre en œuvre tout transfert de ressources des personnes relativement riches vers les personnes relativement pauvres qui serait nécessaire pour atteindre cet objectif» (p. 789).
On pourrait penser que Pigou se rallie à cet «accord général» puisqu’il évoquait lui-même «l’action directe de l’État avec, si nécessaire, des aides de l’État.» Or, si ces transferts pourraient améliorer le sort des plus défavorisés, ils conduiraient à une réduction du «dividende national.» Après une démonstration assez confuse, Pigou en vient à l’argument décisif: «dans la situation actuelle, aucune manipulation de la répartition ne permettrait d’assurer à tous les citoyens un niveau de vie suffisamment élevé. Les réformateurs sociaux doivent donc renoncer à leurs espoirs: il est inévitable que le minimum national doive encore être fixé à un niveau déplorablement bas» (pp. 792-793).
Le raisonnement est donc sans appel et fonctionne en trois temps: 1. les bas salaires sont choquants ; 2. mais une augmentation du salaire minimum détruirait des emplois ; 3. mieux vaudrait donc des transferts sociaux ; 4. malheureusement, ils ne seraient pas suffisants pour vraiment améliorer la situation des plus démunis et réduiraient le revenu national. Voilà un bel exemple d’effet pervers, un artifice classique de la rhétorique réactionnaire [13].
Un siècle après Pigou, le raisonnement n’a pas vraiment changé: le salaire minimum n’est pas le bon outil pour lutter contre la pauvreté, mieux vaut donc recourir à diverses formes de prestations. Tel est, en France, l’argument-clé du «groupe d’experts sur le salaire minimum.»
Le nouveau dogme est installé. Philip Wicksteed, un économiste marginaliste disciple de Stanley Jevons ne fait que le répéter. Si un individu, explique-t-il, demande plus que «la valeur économique qu’il produit pour quelqu’un d’autre (…) ou si on le fait pour lui [le syndicat], personne ne l’emploiera, car chacun préférera se passer de ses services plutôt que de les payer au-delà de ce qu’ils valent [14]» (p. 77). L’intérêt de Wicksteed est que – bien que pasteur – il a du mal à habiller «scientifiquement» ses intérêts de classe: «nous, les membres de la classe moyenne, savons très bien ce que nous ferions si les salaires des domestiques étaient doublés.» Et si une loi devait imposer ce doublement, elle «n’améliorerait en rien le sort des domestiques que nous aurions cessé d’employer» et les législateurs «découvriraient avec étonnement qu’il y avait un problème» (p. 79).
Sans le vouloir, Wicksteed va pourtant mettre le doigt sur l’une des failles de la théorie néo-classique en reconnaissant «que toute richesse est un produit social ; qu’il est impossible de démêler l’apport précis de chaque individu ; et que la répartition de la richesse doit obéir à des lois sociales.» Sans le savoir, il retrouve le constat qu’avait fait, bien avant lui, l’économiste socialiste Thomas Hodgskin [15]: dans la mesure où la production est collective, «il n’y a plus rien que l’on puisse appeler la rémunération naturelle du travail individuel (…) la question est de savoir quelle part de ce produit réalisé en commun doit aller à chacun des individus engagés dans ce travail» (p. 85).
Mais leurs conclusions sont évidemment différentes. Là où Hodgskin pense qu’il n’y a pas «d’autre manière de trancher cette question que de laisser les travailleurs eux-mêmes en décider librement» (p. 85), Wicksteed décrète que le terme de «salaire» n’a de sens que dans le champ de l’économie. Par conséquent, la notion de «salaire décent» doit être remplacée par un «ensemble de dispositifs qui relèvent d’une autre sphère [que l’économie]» (p. 78).
Décidément, bien des argumentaires contemporains sont présents dès le XIXème siècle. Ils reposent sur la distinction opérée entre deux champs: celui de l’économie «pure» et celui des «lois sociales.» Dans la sphère de l’économie prévalent des lois contraignantes auxquelles il faut se soumettre, sous peine de déclencher des effets pervers. C’est donc à l’extérieur que l’on peut envisager des objectifs de justice sociale. Mais cette partition ne pouvait durablement résister à l’irruption des luttes sociales.
De la lutte contre le sweating system aux premières lois
Le terme de sweating system est impossible à traduire (sweat signifie suer). Il désignait le travail à façon chez des particuliers ou dans de petits ateliers ; les fabricants fournissaient les matériaux, parfois des outils, puis récupéraient les produits finis, pour lesquels les travailleurs – en grande partie des travailleuses – étaient payés à la pièce. Le terme a été progressivement étendu au travail dans les usines pour désigner les formes de surexploitation.
En 1888 est créée une commission ad hoc de la Chambre des Lords (Select Committee of the House of Lords on the Sweating System) qui officialise ainsi la notion de sweating system. Dans son rapport final publié en 1890, elle en propose (après maintes délibérations) la définition suivante: «un taux de salaire insuffisant pour couvrir les besoins des travailleurs ou hors de proportion par rapport au travail effectué ; des heures de travail excessives; l’insalubrité des maisons dans lesquelles le travail est effectué [16]» (p. 388). La commission évalue à un quart la proportion de la force de travail industrielle entrant dans cette définition. Plus tard, le terme servira à désigner toutes les formes de surexploitation.
C’est dans ce contexte que se développent les enquêtes sociologiques sur les conditions de vie et de travail. Les plus influentes sont celle de Seebohm Rowntree [17] et surtout celle, volumineuse, de Charles Booth, dont la publication s’étale de 1889 à 1902 [18]. On voit aussi apparaître une réflexion autour de la pacification des relations professionnelles: Industrial Peace sera par exemple le titre d’un des premiers ouvrages de Pigou, publié en 1905 [19].
En 1906, une exposition est organisée par le Daily News pour dénoncer les méfaits du sweating system à domicile. On pouvait y observer des travailleurs (principalement des travailleuses) à l’oeuvre, assister à des conférences, comme celles de George Bernard Shaw ou James Ramsay MacDonald, (futur premier ministre travailliste), et même à des projections sur lanterne. Le guide de l’exposition [20] est un document fascinant qui comporte une riche iconographie et une analyse détaillée (temps de travail, revenu, etc.) des différentes activités.
Cette exposition était le premier pas vers la fondation, quelques mois plus tard, de la National Anti-Sweating League qui organise en octobre 1906 une conférence pour un salaire minimum [21]. Cette conférence rassemble les représentants des syndicats, des partis politiques de gauche et d’organisations de femmes comme la Women’s Co-operative Guild. Elle réunit 341 délégués représentant 2 millions de travailleurs organisés. La forte proportion de femmes concernées explique que ce sont principalement des organisations de femmes qui ont été à l’initiative sur ce terrain, plutôt que les syndicats: en témoigne une autre conférence sur les sweated industries qui s’est tenue en 1906 à Manchester [22].
Vers le salaire minimum
L’un des principaux conférenciers est William Pember Reeves ; il a été ministre néo-zélandais du travail de 1892 à 1896, et à ce titre le promoteur de l’une des premières expériences de minima de branches. Il décrit en détail (pp. 69-72) les trois étages du système néo-zélandais: «On cherche d’abord à obtenir un accord de branche entre le patron et les travailleurs (master and men) ; le règlement des différends est ensuite assuré par des bureaux de conciliation ; et, en dernière instance, c’est la Cour d’arbitrage qui a autorité pour régler les différends.» Il suggère une expérimentation consistant à «prendre le système néo-zélandais tel qu’il est mais, au lieu de l’appliquer de façon générale, de dresser une liste des secteurs auxquels vous pensez qu’il pourrait s’appliquer.»
Reeves ne cache pas («je ne veux pas naviguer sous de fausses couleurs devant vous») que ce dispositif a pour objectif «la prévention des grèves et des lock-out, qui sont une nuisance pour le public et dont les conséquences pour les travailleurs qui y participent sont injustes et arbitraires.» Bref, Reeves pense comme son «ami Sidney Webb» qu’il existe «un meilleur moyen de régler les conflits du travail que l’ancien système de grèves et de lock-out.» Cet «ancien système» doit être abandonné: «vous devriez dire aux gens: “nous allons avoir des conditions équitables et la paix sociale”.»
Ces mobilisations conduiront au vote du Trade Boards Act en 1909, à la suite de la victoire du parti libéral (dont le gouvernement comprenait des représentants du Labour Party). Cette législation est l’aboutissement d’un processus de prise de conscience et de mobilisations sociales, dans un contexte économique difficile. La période 1873-1896, ouverte par une panique financière, a en effet été marquée par un ralentissement de l’activité économique et a pu être baptisée «la longue dépression.» Cette conjoncture s’est accompagnée d’émeutes, notamment à Londres au cours des hivers 1886 et 1887. Cependant le Trade Boards Act ne concerne que quatre secteurs industriels: confection ; fabrication de boîtes en papier ; dentelle et filets ; fabrication de chaînes [23].
Un libéralisme sui generis
Le gouvernement est alors à majorité libérale, mais il s’agit d’un «nouveau libéralisme» dont il est intéressant d’examiner les références doctrinales, assez éloignées du libéralisme classique. Leonard Hobhouse, l’un des principaux théoriciens de ce courant, écrit par exemple: «Il y a en quelque sorte un problème dans le système social, un défaut dans la machine économique que le travailleur, en tant qu’individu, ne peut corriger. Il est le dernier à avoir son mot à dire sur le contrôle du marché. Ce n’est pas de sa faute s’il y a surproduction dans son industrie, ou si un nouveau procédé moins coûteux déprécie sa compétence particulière. Il ne dirige ni ne réglemente l’industrie. Il n’est pas responsable de ses fluctuations, mais il doit pourtant en supporter les conséquences. C’est pourquoi ce n’est pas la charité, mais la justice qu’il demande [24]» (pp. 158-159).
Ce réquisitoire conduit à une justification de l’intervention de l’Etat: sa fonction est «d’assurer les conditions permettant aux citoyens de gagner par leurs propres efforts tout ce qui est nécessaire à leur pleine efficacité civique. Le “droit au travail” et le droit à un “salaire décent” (living wage) sont tout aussi légitimes que les droits de la personne ou de la propriété. Ils sont donc partie intégrante d’un ordre social équilibré.»
Un des autres théoriciens de ce courant est l’économiste John Hobson (plus connu pour ses travaux sur l’impérialisme). Même s’il ne se réclame pas du socialisme, il se rapprochera du Labour Party après la première guerre mondiale. En tout cas, il récuse clairement les présupposés du libéralisme classique, et notamment l’idée selon laquelle «un travailleur devrait être libre de vendre son travail comme il l’entend.» Cette prétendue liberté de travailler se ramène à la «liberté de travailler comme en décide son employeur», de sorte que le travailleur n’est pas «une unité isolée, dont le contrat de travail ne concernerait que lui-même et son employeur [25]» (p. 187).
Hobson cherche donc à répondre à l’argumentation classique (et encore actuelle) qu’il résume ainsi, dans une conférence où il traite de l’influence d’un salaire minimum légal sur l’emploi: «Les opposants à une législation sur le salaire minimum font valoir l’argument selon lequel elle entraînerait une réduction du volume de l’emploi dans les secteurs soumis au sweating system, qui ne serait pas compensée par une augmentation correspondante de l’emploi dans d’autres branches ; en un mot, qu’il aggraverait le problème du chômage» (p. 34).
Les propositions avancées par Hobson s’inspirent notamment de l’ouvrage de Ludwig Stein, La question sociale à la lumière de la philosophie [26]. Il résume ainsi, en la reprenant à son compte, le projet d’un «minimum vital» qui pourrait «être obtenu en partie par l’emploi public, en partie par l’influence exercée directement par l’industrie d’Etat sur le maintien de conditions de travail et de salaires décents dans l’industrie privée, en partie par le prélèvement d’impôts.» Hobson évoque favorablement la politique alternative proposée par Stein, qui viserait à restreindre le «pouvoir économique des capitalistes privés», et qui repose sur «la taxation des revenus, du patrimoine, et des successions [27]» (p. 381). Il est sans doute superflu de remarquer la similitude de ces propositions avec celles avancées par Thomas Piketty dans son dernier ouvrage [28].
Pour Hobson [29], le Trade Boards Act s’inscrit dans une logique qui refuse de s’en remettre au libre jeu du marché: «La fixation des salaires par la prétendue libre concurrence ne garantit aucunement l’obtention d’un salaire d’efficience, ni même de subsistance. Du point de vue des profits immédiats des employeurs, le sweating est toujours payant. Mais du point de vue de la société, il ne paie jamais. En ce sens, la politique des travailleurs organisés, qui cherche à mettre en oeuvre la doctrine du salaire minimum, n’est pas seulement une politique d’autoprotection des classes travailleuses, mais une politique sociale salutaire. C’est pour cette raison que l’Etat intervient en créant des Trade Boards pour faire respecter l’application de ce principe dans ce qu’on appelle les industries du sweating et établit, au moins en théorie, sa validité pour tous les emplois et marchés publics» (p. 197).
Ces longs extraits sont autant de pavés dans la mare de la théorie économique dominante qui se réclame des lois du pur calcul économique. On y trouve déjà tous les ingrédients des propositions aujourd’hui considérées comme hétérodoxes, et notamment la responsabilité de l’Etat pour le respect des droits à l’emploi et à un salaire décent, qui implique une redistribution des richesses.
Les réticences syndicales
Dans ses évaluations ex post de l’application du Trade Board Act [30], Richard Henry Tawney, un socialiste chrétien et un réformateur social influent, fait «un constat aussi courant qu’habituellement ignoré» qui préfigure la théorie moderne du salaire d’efficience: «avec l’augmentation des salaires versés, la qualité des chaînes produites s’est améliorée.» Autrement dit, «les mauvais salaires produisent un mauvais travail» (p. 113).
Il y a cependant une réserve, glissée au détour de l’étude de Tawney sur l’industrie de la confection [31]: «Il n’est pas nécessaire de soulever la question plus large d’un secteur qui serait incapable de verser les faibles salaires minima fixés par le Trade Board de la confection, parce que notre enquête suggère que l’industrie de la confection peut le faire» (p. 105). Mais quid des autres? Et Tawney se demande ce qui se passerait dans une phase de mauvaise conjoncture et reconnaît qu’il est «encore trop tôt pour le déterminer [32]» (p. 70).
Un peu plus tard, Tawney insistera cependant sur la rupture introduite par la nouvelle législation qui a signifié «l’abandon silencieux de la doctrine, défendue depuis trois générations avec une intensité presque religieuse, selon laquelle les salaires doivent être fixés par la libre concurrence, et par la libre concurrence seule [33]».
Tawney a fait un autre constat important. Dans ses enquêtes, il a observé la méfiance des syndicats qui craignent de voir leur rôle diminué: une fois le salaire minimum fixé, les employeurs pourraient en tirer argument pour dire qu’il n’y a plus rien à négocier. Il multiplie les arguments à l’encontre de ces inquiétudes, en expliquant par exemple que l’instauration d’un salaire minimum «ne rend pas le syndicalisme moins nécessaire, car les taux fixés par le Trade Board n’étant qu’un minimum, ils sont inévitablement inférieurs à ce que les sections les plus prospères d’une industrie peuvent se permettre de payer [34]» (p. 91).
Cette réticence à l’égard du salaire minimum a été longtemps la position des syndicats anglais qui craignaient que le champ de la négociation collective soit réduit ou que, fixé trop bas, le minimum puisse servir de référence aux autres niveaux de salaires. On retrouve cette même méfiance aux Etats-Unis, où Samuel Gompers, le dirigeant de l’AFL (American Federation of Labor) s’est toujours opposé aux lois sur le salaire minimum. Pour lui, «le minimum deviendrait le maximum et nous aurions vite besoin de prendre nos distances.» Plutôt qu’un salaire minimum unique (dont Gompers se refuse par ailleurs à préciser le niveau) mieux vaut un «principe, une règle de vie globale [35].»
Dans une lettre à Maud Younger [36], une syndicaliste et féministe, Gompers est encore plus catégorique: si un salaire minimum légal était instauré, «il n’y aura plus qu’un pas à franchir pour forcer les salariés à travailler selon le bon vouloir de leurs employeurs, ou de l’État, et ce serait alors de l’esclavage. Nous voulons qu’un salaire minimum soit instauré, mais nous voulons qu’il le soit grâce à la solidarité des travailleurs eux-mêmes, s’appuyant sur la force de leurs syndicats, plutôt que par une quelconque loi.».
Ces mêmes réticences ont longtemps nourri le refus par les syndicats allemands de l’industrie de l’instauration d’un salaire minimum, avant qu’ils se rallient finalement à ce projet. Mais le même type d’arguments est encore invoqué, au sein de la CES (Confédération européenne des syndicats) par les syndicats suédois et italiens pour s’opposer à la perspective d’un système européen de salaires minima [37] (Schulten, et al., 2016)
De l’utilité du rétroviseur
La raison d’être de ce bref voyage dans le temps est de montrer que tous les arguments mobilisés sur la question du salaire minimum étaient déjà présents dès les premières heures du capitalisme constitué. Du côté des dominants, la défense des intérêts de classe (n’en déplaise à Marshall) s’est toujours drapée dans les nobles vêtements d’une «science» de plus en plus formalisée, mais dont le message est à peu près immuable: en voulant améliorer leur sort, les «gens ordinaires» (les gens «qui ne sont rien», dirait Macron) risquent de dégrader la situation économique. Et, faute de réussir à bouleverser les rapports sociaux, les dominés oscillent entre législation nationale et compromis locaux. (Décembre 2019)
Notes
[1] Muriel Pénicaud, « Pas de « coup au pouce » au Smic car « ça détruit des emplois » », Europe 1, 9 décembre 2018.
[2] Joseph Brown, The Food of the People, 1865.
[3] John Stuart Mill, Principes d’économie politique, Tome1, 1848.
[4] John Ramsay McCulloch, A Treatise on the Circumstances which Determine the Rate of Wages and the Condition of the Working Classes, 1826.
[5] Michel Husson, Créer des emplois en baissant les salaires ? Editions du Croquant, 2015. Voir cette synthèse: « Coût du travail et emploi : une histoires de chiffres », juillet 2014.
[6] William Thornton, On Labour. Its Wrongful Claims and Rightful Dues, Its Actual Present and Possible Future, 1869.
[7] John Stuart Mill, « Thornton on Labour and Its Claims » Fortnightly Review, May & June 1869.
[8] Joan Robinson, « What has become of the Keynesian Revolution? » in Joan Robinson (ed.), After Keynes, 1973.
[9] Alfred Marshall, « The Old Generation of Economists and the New », The Quarterly Journal of Economics, Vol. 11, No. 2, January 1897.
[10] John Bates Clark, « The Minimum Wage », The Atlantic Monthly n°112, September 1913.
[11] Arthur Pigou, Unemployment, 1913.
[12] Arthur Pigou, The Economics of Welfare, 1920.
[13] Alfred Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, 1991 ; The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy.
[14] Philip Wicksteed, « The Distinction Between Earnings and Income, and Between a Minimum Wage and a Decent Maintenance: A Challenge », dans William Temple, ed,. The Industrial Unrest and the Living Wage, 1913.
[15] Thomas Hodgskin, Labour Defended Against the Claims of Capital, 1825.
[16] « What is Sweated Industry? », extrait du Fifth Report from the Select Committee of the House of Lords on the Sweating System (1890); reproduit dans W. H. B.Court, British Economic History 1870-1914. Commentary and Documents, 1965.
[17] Seebohm Rowntree, Poverty, A Study of Town Life, 1901.
[18] Albert Fried and Richard M. Elman, eds (1969), Charles Booth’s London. A Portrait of the Poor at the Turn of the Century, Drawn from His « Life and Labour of the People in London ».
[19] Arthur Pigou, Principles & Methods of Industrial Peace, 1905.
[20] Richard Mudie-Smith, Handbook of the « Daily News » Sweated Industries’ Exhibition, 1906.
[21] National Anti-Sweating League, Report of Conference on A Minimum Wage, 1907.
[22] Chetham’s Library, « Sweated industries », June 2018 .
[23] J. J. Mallon, The Trade Boards Act, National Anti-Sweating League, 1910 ; appendices to Philip Snowden, The Living Wage, 1912.
[24] Leonard Hobhouse, Liberalism, 1911.
[25] John Hobson, Problems of Poverty. An Inquiry into the Industrial Condition of the Poor, 1891.
[26] Ludwig Stein, Die sociale frage im lichte der philosophie, 1897.
[27] John Hobson, « review of Ludwig Stein, Die Sociale Frage im Lichte der Philosophie », The Economic Journal, Vol. 8, No. 31, September 1898.
[28] Thomas Piketty, Capital et idéologie, 2019.
[29] John Hobson, Work and Wealth. A Human Valuation, 1914.
[30] Richard Tawney, The Establishment of Minimum Rates in the Chain-Making Industry Under The Trade Boards Act of 1909, 1914.
[31] Richard Tawney, The Establishment of Minimum Rates in the Tailoring Industry Under The Trade Boards Act of 1909, 1915.
[32] Richard Tawney, 1914, déjà cité.
[33] Richard Tawney, « On minimum wage fixing » in League of Nations Union, Towards industrial peace, 1927 ; cité par Sheila Blackburn, « Ideology and Social Policy: The Origins of The Trade Boards Act », The Historical Journal, Vol. 34, No. 1, March 1991, p. 43.
[34] Richard Tawney, 1915, déjà cité.
[35] Samuel Gompers, « A Minimum Living Wage », American Federationist, 1898, cité par Thomas A. Stapleford, « Defining a ‘living wage’ in America: transformations in union wage theories, 1870–1930 », Labor History, Vol. 49, No. 1, February 2008, p. 3.
[36] Samuel Gompers, « Letter to Maud Younger », May 17, 1912, dans Peter J. Albert, Grace Palladino, eds, The Samuel Gompers Papers, volume 8, 2001
[37] Thorsten Schulten, Torsten Müller et Line Eldring, « Pour une politique de salaire minimum européen : perspectives et obstacles », La revue de l’Ires n° 89, 2016/2.